À l’aube d’un nouvel ordre mondial façonné par la rivalité sino-américaine
Avec Trump, la tournure que prendra la rivalité entre Pékin et Washington, aujourd’hui d’ordre économique et non dénuée de formes de coopération, reste incertaine. Or l’ordre mondial en sera redéfini…


L’avènement d’un ordre global unifié autour de valeurs universelles semble plus que jamais chimérique. La pandémie de Covid-19, le conflit russo-ukrainien et la guerre au Proche-Orient ont amplifié les tensions géopolitiques, déjà intensifiées au cours des deux dernières décennies par l’essor de la Chine et d’autres pays émergents ainsi que par le néo-bellicisme de la Russie. Un nouvel équilibre mondial se cristallise autour de la rivalité économique des deux puissances hégémoniques que sont la Chine et les États-Unis. L’issue de ce bras de fer et les conséquences pour les autres pays demeurent hautement incertaines au moment où l’imprévisible, mais déterminé, Donald Trump revient à la Maison Blanche.
Le retour de Donald Trump à la Maison Blanche depuis le 20 janvier 2025 ouvre une nouvelle ère d’incertitude et d’instabilité dans les relations internationales.
Érigé en principe de politique étrangère par l’administration Trump I, le transactionnalisme vise à redéfinir les bases de l’engagement international des États-Unis (notamment sur le plan militaire dans le cadre de l’OTAN) en conditionnant cet engagement à des contreparties fournies par les partenaires de Washington.
Cette logique transactionnelle bat en brèche certaines alliances traditionnelles et redonne corps au concept de géo-économie. Celle-ci combine l’utilisation d’outils économiques (commerce, investissement, sanctions) pour atteindre des objectifs politiques qui s’inscrivent dans une dimension et une logique géopolitique pour servir des intérêts de puissance et d’influence.
De la mondialisation économique à la fragmentation géopolitique
L’adhésion de la Chine à l’Organisation mondiale du commerce (OMC) en 2001 a accéléré la mondialisation économique, sans pour autant induire l’avènement d’un monde unifié autour de valeurs universelles. Le capitalisme d’État chinois apparaît à la fois pragmatique et immuable face à l’économie de marché que prônent des démocraties libérales minées par la désindustrialisation, le déclassement social et le populisme rampant. Alors que les grands enjeux globaux – changement climatique, pandémies, migrations – nécessiteraient une collaboration efficace entre l’ensemble des acteurs internationaux, le multilatéralisme défaille.
À lire aussi : Mondialisation : comment la sécurité économique est devenue la priorité
La fragmentation du monde semble à l’œuvre, et l’unité transatlantique paraît vaciller depuis que l’administration Obama a entériné un pivot vers la région indo-pacifique. Quant à l’OMC, elle était déjà fragilisée avant le premier mandat de Trump, l’administration Obama ayant contribué à rendre l’organe de règlement des différends commerciaux (ORD) largement inopérant.
Par ailleurs, la toute-puissance du dollar et l’extraterritorialité du droit américain sont de plus en plus contestées par de nombreux pays, et non seulement par les BRICS+. Les sanctions internationales contre la Russie, que ce soit sur les hydrocarbures ou les biens à usage dual (utilisés dans le civil, mais pouvant être détournés à des fins militaires), sont elles aussi remises en cause et contournées par des puissances comme la Chine, l’Inde, la Turquie ou les pays d’Asie centrale.
À lire aussi : BRICS+ : Moscou cherche à structurer un nouvel ordre mondial « post-occidental »
Si la Chine repense actuellement sa stratégie d’influence tous azimuts, elle a su déployer son soft power, spécialement depuis 2013 avec « les Nouvelles routes de la soie » (Belt & Road Initiative), et est devenue le principal partenaire commercial et bailleur bilatéral d’un certain nombre de pays d’Asie, d’Afrique et d’Amérique latine. L’Inde, la Turquie et les pays du Golfe n’ont pas été en reste pour étendre leur influence, notamment sur le continent africain, où la présence russe s’est également accrue.
Deux puissances systémiques dans un monde multipolaire
La marche de l’économie mondiale reste dominée par la relation de plus en plus antagonique entre les deux puissances hégémoniques. États-Unis et Chine entretiennent une relation complexe de « coopétition » (de coopération et de confrontation).
Le fil de la coopération et de la communication est maintenu compte tenu, entre autres, de leur interdépendance économique (11 % des exportations chinoises sont destinées aux États-Unis) et financière (plus de 800 milliards de dollars en bons du Trésor américain sont détenus par la Chine). La confrontation demeure, pour le moment, sur le terrain économique et se cristallise surtout sur les questions technologiques et de transition énergétique.
Pendant ce temps, l’Union européenne travaille encore à coordonner une politique industrielle technologique et verte. Et ce, en dépit de son leadership en termes de taxonomie verte et de politique de transition énergétique, qu’illustre la mise en place du Mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (MACF). Dans sa quête de source alternative au gaz russe, l’UE est de plus en plus dépendante des États-Unis (premier producteur et exportateur de gaz naturel liquéfié). Et à l’heure où le parapluie militaire américain n’est plus une assurance tout risque, la politique de défense commune demeure un défi pour les 27 pays de l’Union.
À lire aussi : Un parapluie nucléaire franco-britannique pour l’Europe est-il envisageable ?
Les liens économiques, financiers, politiques et historiques que les autres pays entretiennent avec les États-Unis et la Chine constituent des forces de rappel qui les ramènent souvent à la realpolitik.
Le monde n’est pas binaire ou bipolaire pour autant. En effet, l’alignement pur et parfait des pays développés et des pays émergents et en développement (PED) sur l’une ou l’autre des deux économies systémiques mondiales ne va pas de soi. Le pragmatisme économique, l’émancipation, l’autodétermination et la souveraineté nationale constituent les principes de base. Ils façonnent des postures géopolitiques non alignées et équilibrées, voire multi-alignées, que l’on retrouve chez certaines puissances régionales et des pays pivots (Inde, Turquie, Afrique du Sud, Brésil, Arabie saoudite), qui jouent parfois un rôle de « chevaux de Troie » pour accéder aux marchés américain (Mexique) et européen (Hongrie, Serbie, Turquie).
La menace d’une « guerre commerciale » à grande échelle
Initiée en 2018 par l’administration Trump I, non remise en cause par l’administration Biden et désormais étendue à l’Europe, au Canada et à certains pays émergents, la « guerre commerciale » contre la Chine devrait s’intensifier sous Trump II.
Des menaces aux actes, il n’aura pas fallu attendre plus de deux semaines après son investiture pour que Donald Trump impose des droits de douane supplémentaires de 10 % sur les importations de Chine. Idem pour les partenaires privilégiés des États-Unis au sein de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique (ex-ALENA), avec des droits de douane de 25 % annoncés sur toutes les importations mexicaines et la plupart des importations canadiennes (hors énergie).
Comme quelques jours plus tôt envers la Colombie, ces droits de douane ont été suspendus la veille de leur application, le 4 février 2025, suite aux mesures prises par le Canada et le Mexique pour renforcer leurs contrôles aux frontières dans la lutte contre le trafic de drogue et face à la réaction négative des marchés financiers.
Autre partenaire traditionnel des États-Unis, l’UE est aussi dans le collimateur, faisant craindre à tout autre pays d’entrer dans la ligne de mire de l’administration américaine. Nul n’a intérêt économiquement à une escalade entre mesures protectionnistes et mesures de rétorsion, qui fait courir un risque important pour la trajectoire de l’économie mondiale en 2025 et au-delà.
Entre populisme électoraliste et chantage commercial, les mesures trumpiennes sont la pierre angulaire de la politique MAGA (Make America Great Again) de soutien de l’industrie et de l’emploi. Donald Trump prône en outre un rééquilibrage des balances commerciales bilatérales, nettement déficitaires avec de nombreux pays (comme le montre le graphique ci-dessous), ainsi que la réduction de la fiscalité nationale – ce que compenserait, en théorie et a priori seulement partiellement, l’augmentation des droits de douane. Le corollaire de cette politique est un risque de relance des pressions inflationnistes sur les prix à la production et à la consommation, préjudiciables pour le pouvoir d’achat des ménages et pour de nombreuses entreprises américaines.

Du côté de la Chine, les dirigeants apparaissent plus résolus en 2025 que lors du premier mandat de Donald Trump pour réagir fermement aux mesures protectionnistes imposées par les États-Unis, selon le triptyque représailles, adaptation et diversification. Pékin a ainsi annoncé une hausse de 10 à 15 % des droits de douane sur les produits énergétiques en provenance des États-Unis à compter du 10 février 2025.
Plus fondamentalement, la stratégie d’autosuffisance domestique s’est traduite par des mesures protectionnistes sur certains secteurs dans lesquels la Chine ne dispose pas encore d’avantages comparatifs décisifs (pharmacie, cosmétiques, semi-conducteurs, aéronautique). Dans le même temps, le ciblage des secteurs porteurs sur lesquels la Chine bénéficie d’un avantage de compétitivité-coût et technologique, façonné par le capitalisme d’État (intense concurrence couplée à des subventions massives voire à du dumping à l’export), soutient les recettes d’exportations. Dans ces secteurs – la chimie, les machines-outils et l’automobile – la Chine concurrence désormais frontalement des pays traditionnellement en pointe comme l’Allemagne et le Japon.
Faiseur de marché des matières premières en tant qu’importateur, producteur ou transformateur, la Chine a, inversement, imposé en 2023 et 2024 des restrictions aux exportations de métaux critiques pour les semi-conducteurs, télécommunications et véhicules électriques.
Face à ce choc des titans, certains pays émergents et en développement pourraient en sortir fragilisés, eu égard à leur forte dépendance vis-à-vis des États-Unis et de la Chine (voire de l’Europe), alors que d’autres pourraient au contraire être renforcés grâce à leur positionnement géostratégique favorable, voire à leur rente géopolitique.![]()
Sylvain Bellefontaine ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.




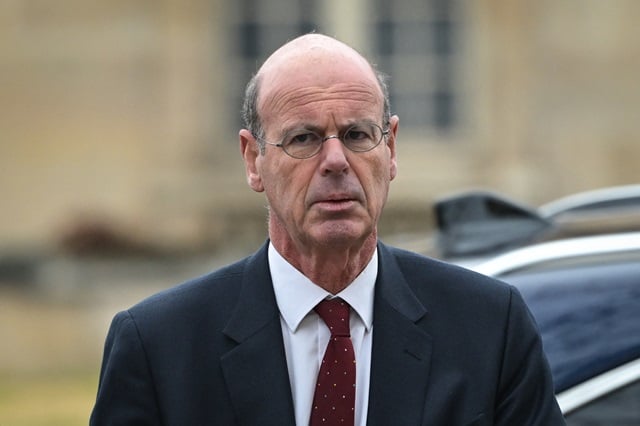






























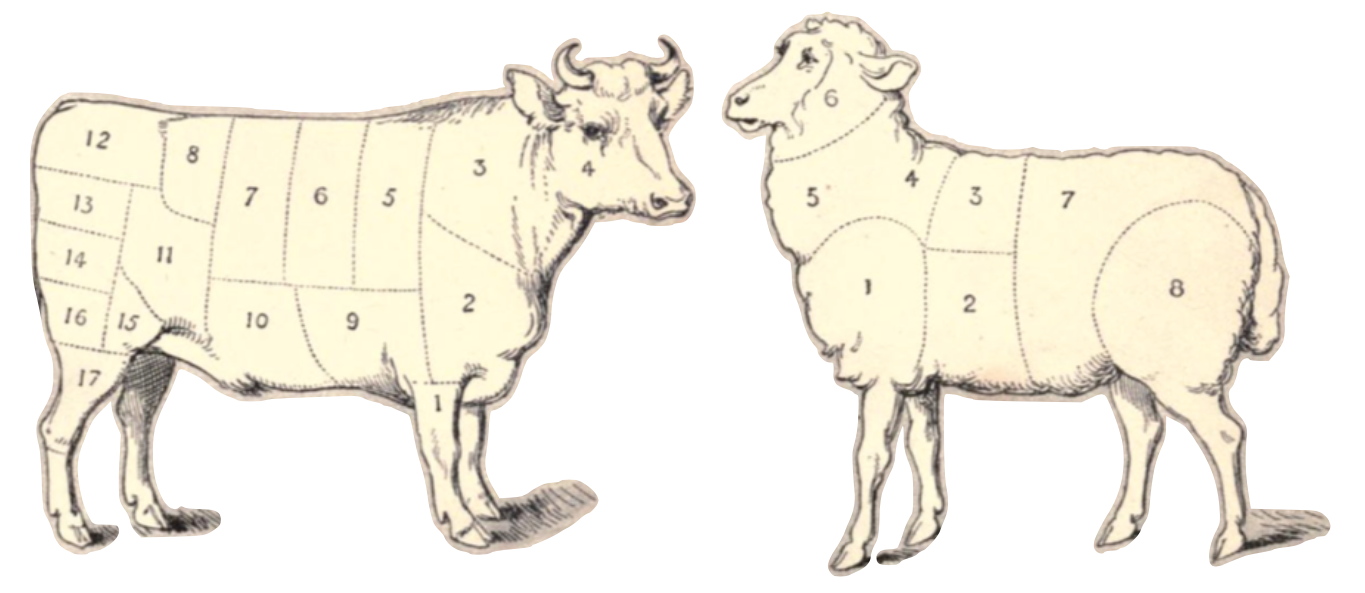






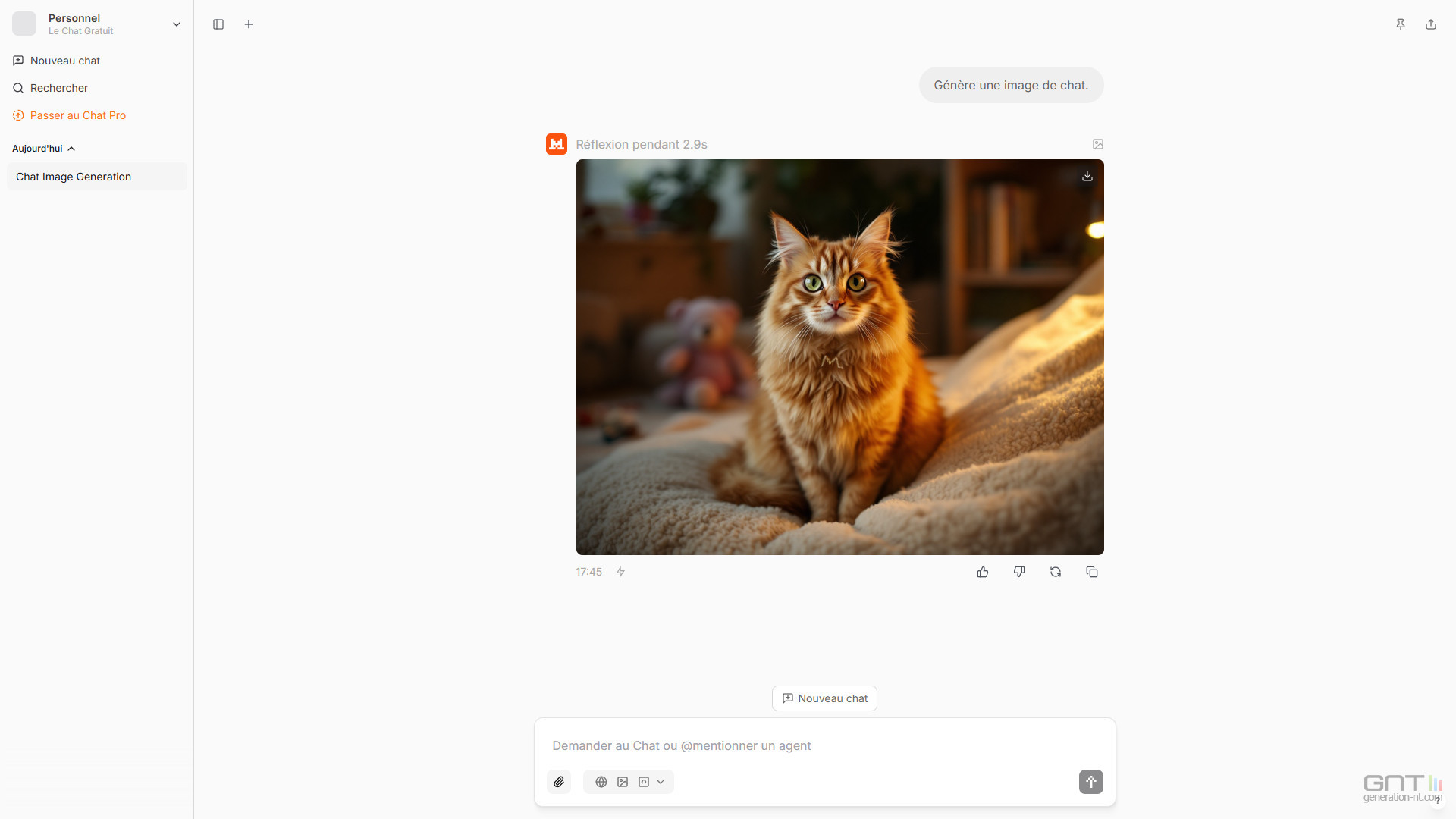
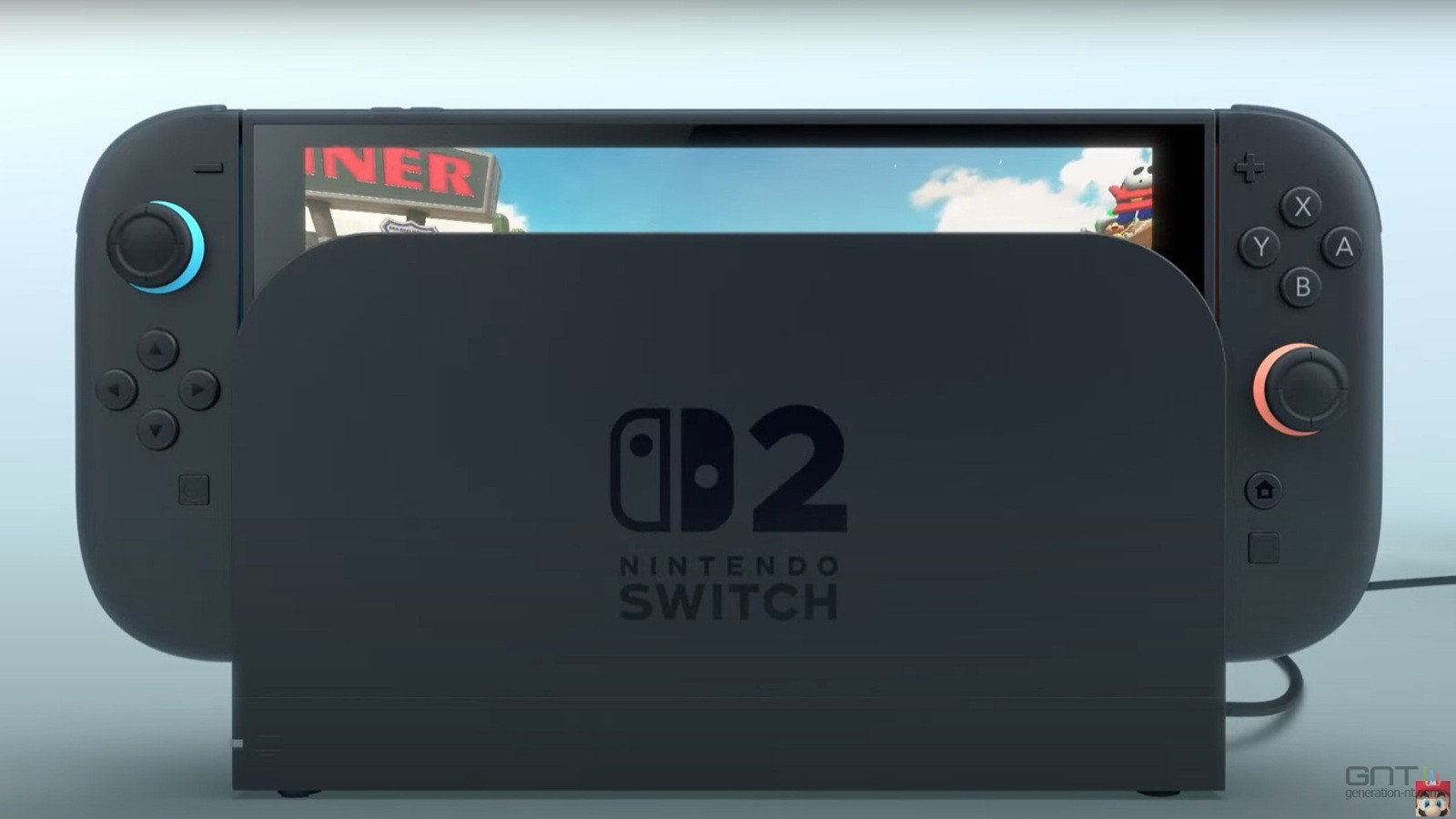

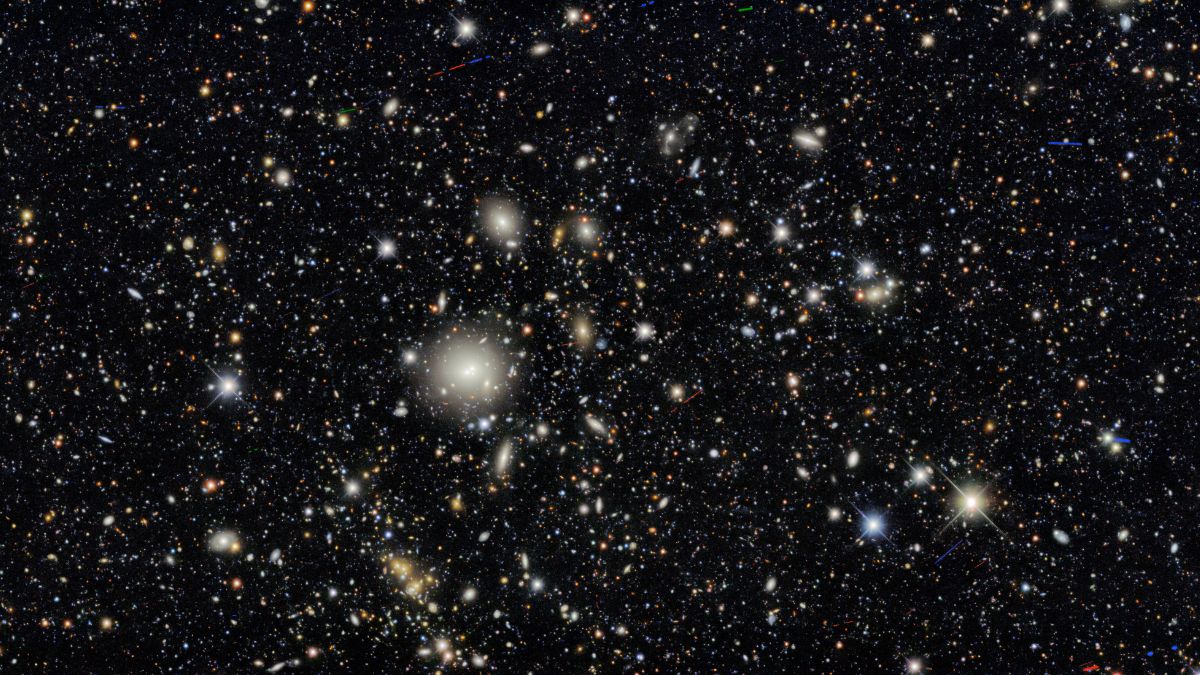






![Flexibilité : la CRE compte sur le marché [compte-rendu]](https://www.greenunivers.com/wp-content/uploads/2025/02/image-6.png)





















