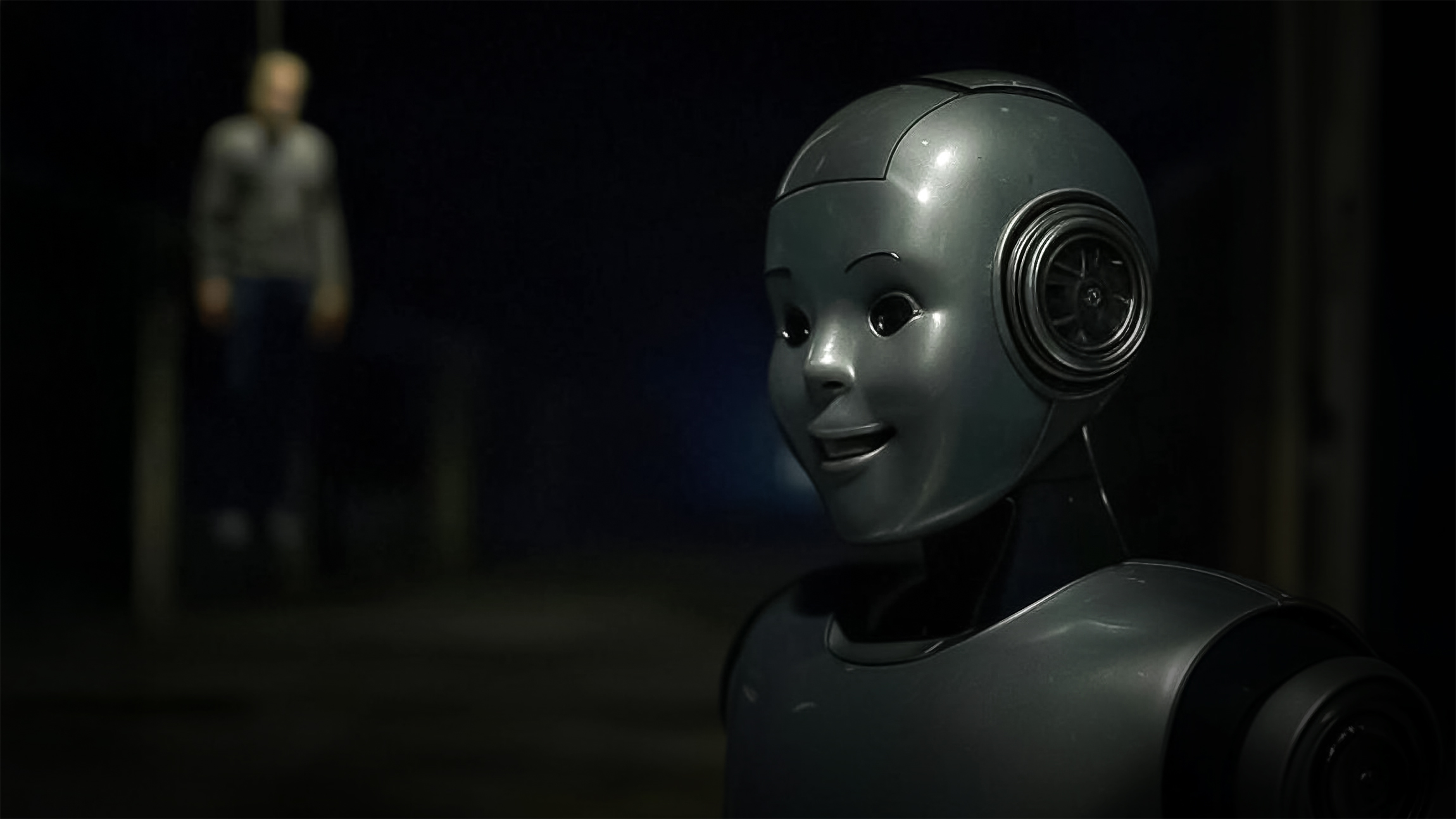Expulsions, sanctions et menaces : un séisme d’ampleur régionale entre Trump et la Colombie
La Colombie du président de gauche Gustavo Petro s’est opposée aux expulsions de ses ressortissants, ordonnées par Donald Trump, avant de devoir plier l’échine face à la menace de sanctions nord-américaines.

Le président de la Colombie, Gustavo Petro, ancien guérillero de gauche, n’a pas hésité à s’engager dans un bras de fer avec Donald Trump sur la question de l’expulsion de migrants colombiens depuis les États-Unis. Il a toutefois dû céder après des échanges de menaces de sanctions réciproques, obtenant tout de même en retour l’assurance que ces expulsions se dérouleraient désormais dans des conditions plus humaines. Un épisode qui en dit long sur ce que sera la relation entre Washington et le reste du continent américain au cours des quatre années à venir.
Le 26 janvier dernier, la troisième puissance économique latino-américaine, la Colombie, s’est réveillée en crise. Pendant la nuit, vers 3 heures du matin, le président Gustavo Petro s’était lancé dans une offensive sur X pour commenter l’expulsion par l’administration Trump de plusieurs centaines de ressortissants colombiens. L’hôte du palais Nariño avait commencé en proposant d’accueillir ses compatriotes avec des drapeaux et des fleurs sur le tarmac, avant de supprimer le tweet en question et d’en publier un autre, annonçant qu’il refusait l’atterrissage des charters prévu à 6h45 et à 10 heures du matin, soit seulement trois heures plus tard. Les avions militaires étatsuniens ont donc été contraints à faire demi-tour, présageant la première crise diplomatique contemporaine qui allait opposer les États-Unis à leur plus fidèle allié du sous-continent américain.
Un bras de fer attendu
Les expulsions massives de migrants ne sont pas l’apanage de Donald Trump. Démocrates comme républicains ont fait de cette pratique une constante de la politique migratoire nord-américaine. À ce jour, c’est Barack Obama qui détient le record, 2,8 millions de personnes ayant été renvoyées hors des États-Unis sous sa présidence.
Depuis son retour à la Maison Blanche, le magnat de l’immobilier ne semble pas (encore) avoir modifié la fréquence des expulsions, mais il a déjà changé leurs modalités. Rafles, menottes, chaînes et compartiments sécurisés : c’est dans cet environnement carcéral que les personnes migrantes devaient être renvoyées en Colombie.
Pour Petro, une ligne rouge était franchie. À 6h45, il publiait un tweet sans appel :
« Les États-Unis ne peuvent pas traiter les migrants colombiens comme des délinquants. [Ils] doivent établir un protocole de traitement digne avant que nous les recevions. »
Personne ne s’attendait à une lune de miel entre les deux présidents. Pour prendre la mesure de l’écart qui sépare les deux hommes, rappelons qu’il y a, d’un côté, un ancien guérillero du M-19 (une guérilla urbaine de gauche active entre 1970 et 1990) qui a nommé, après son élection en 2022, une vice-présidente afro-descendante, lauréate en 2018 du prix Goldman pour l’environnement – une récompense qualifiée de « Nobel de l’écologie » – et ancienne avocate ayant défendu les droits des populations autochtones face aux industries extractives ; de l’autre, un milliardaire masculiniste souvent accusé de se montrer très compréhensif à l’endroit du suprémacisme blanc, ayant donné des prérogatives colossales à l’entrepreneur le plus fortuné et le plus fameux du monde, lequel s’est illustré, lors de sa cérémonie d’investiture, en effectuant un salut nazi.
La question était donc moins de savoir si les relations entre ces deux alliés historiques allaient se détériorer, mais plutôt quand. Réponse : au bout de six jours.
Le contre-feu et l’emballement médiatique
Retour sur X. Comme souvent, la communication du président colombien est difficilement lisible. Pourquoi prendre une telle décision, seul, en pleine nuit ? Pourquoi la communiquer sur son compte X et non via les canaux officiels ? À cette question, l’ambassadeur colombien à Washington apportera une réponse qui aura le mérite de la clarté et de la concision : « La vérité ? Je ne sais pas. »
L’emballement médiatique a commencé dès le réveil et, lucides quant à la nature du nouvel occupant du Bureau ovale, les commentaires médiatiques annonçaient un retour de flamme des plus spectaculaires.
Il fallut attendre le début de l’après-midi pour avoir la réponse de Washington. Celle-ci fut publiée sur le réseau Truth Social avec un titre dans lequel était annoncée, sans grande surprise, la promulgation de sanctions. Plus surprenant, celles-ci étaient prévues à l’encontre… non pas de la Colombie (Colombia en anglais) mais de la « Columbia » (sic) : Trump annonçait une augmentation directe des tarifs douaniers à 25 % sur tous les produits, une suspension de la délivrance de visas et une interdiction de séjour pour tous les membres et proches du gouvernement.
En réponse, Petro a porté à son tour à 25 % les droits de douane et invité, par ailleurs, les 15 660 citoyens des États-Unis (ce sont ses propres chiffres) établis de manière irrégulière en Colombie à prendre contact avec ses services administratifs.
S’en est suivi une série de tweets toujours aussi peu diplomates, dans lesquels l’ex-guérillero disait notamment trouver les voyages aux États-Unis « ennuyeux », tout en reconnaissant apprécier les quartiers noirs de New York, et en soulignant son admiration pour des figures culturelles et intellectuelles telles que Noam Chomsky, Walt Whitman ou les anarchistes italiens Sacco et Vanzetti. Une nouvelle salve qui illustre, s’il le fallait encore, l’abysse idéologique qui le sépare de son homologue.
Trump n’est pas un homme d’État, encore moins un homme de lettres : c’est un dealmaker. Il ne fait pas de diplomatie, il met en scène un rapport de force. Et dans ce domaine, les États-Unis et la Colombie ne boxent pas dans la même catégorie. Les sanctions tarifaires annoncées allaient frapper de plein fouet l’économie colombienne, fortement dépendante de ses exportations vers les États-Unis, qui pèsent 27 % du commerce extérieur et représentent 4 % du PIB national. Face à la menace de Trump, les partisans de la realpolitik, et plus largement les adversaires de Petro, dénonçaient un « geste d’humeur » présidentiel aux conséquences désastreuses pour 50 millions de Colombiens. Défendre la dignité des personnes expulsées avait un prix. Un prix colossal. Des milliards de pesos envolés, des milliers d’emplois en péril : une facture salée pour un bras de fer avec Washington.
Accord scellé, polémique relancée : le débat sur les expulsions s’intensifie
Alors que les invectives fusaient sur les réseaux sociaux entre les deux présidents, la diplomatie s’activait en coulisses. Le soir même, un accord était scellé. Lundi matin, la Maison Blanche annonçait une victoire triomphale, totale : la Colombie avait cédé à « toutes les conditions du président Trump », y compris le renvoi des personnes expulsées par avions militaires. Le Palacio Nariño (siège de la présidence colombienne), assurant de son côté avoir obtenu que ces expulsions se déroulent dans des conditions dignes. L’administration de Petro annonçait que la Force aérienne colombienne (FAC) affréterait ses propres avions afin d’assurer que les personnes expulsées feraient le voyage sans chaînes ni menottes.
Dans la matinée du mardi 28 janvier, les premières cohortes de Colombiens expulsés ont atterri sur le tarmac de l’aéroport El Dorado. Très vite, les témoignages ont afflué, dénonçant des conditions de détention brutales sous la nouvelle administration nord-américaine : violences physiques et sexuelles, séparations des enfants, privations de nourriture, conditions insalubres et vols de leurs biens.
Ces récits viennent corroborer les signalements déjà émis au Brésil, au Mexique et au Guatemala ces derniers jours. Ce qui semblait être un simple affrontement diplomatique sur la dignité des expulsés révèle en réalité un enjeu bien plus grave : celui de leur intégrité physique et psychique.
Un schisme régional : quelle Amérique latine face à Trump ?
Ce séisme diplomatique l’a révélé avec force : l’ère de la bonne entente « naturelle » entre les dirigeants des Amériques semble bel et bien révolue.
Si les États-Unis ont toujours exercé une domination sur la région, ils l’avaient, depuis les années 1980 et les vagues d’ouverture économique, revêtue des habits monochromes du partenariat commercial. Une manière d’euphémiser leur hégémonie, qui arrangeait jusqu’ici toutes les parties. Mais la donne a changé. Désormais, les gouvernements démocratiques de la région font face à un dilemme : s’aligner sur la puissance nord-américaine et fermer les yeux sur ses dérives autoritaires, ou choisir l’affrontement, au risque de subir des représailles économiques dévastatrices.
L’érection de ce nouvel ordre régional ne repose plus tant sur des alliances d’États que sur des jeux d’hommes. Et Trump, fidèle à sa logique transactionnelle, soutiendra les siens : Javier Milei en Argentine, Nayib Bukele au Salvador, Daniel Noboa en Équateur. À leurs côtés, d’autres figures émergent, des présidents-vassaux en exercice aux candidats-vassaux du sous-continent, tels qu’Jair Bolsonaro au Brésil ou Eduardo Verástegui au Mexique.
Ce qui semble évident, c’est que la constitution de cette internationale néo-réactionnaire se nourrira des fractures que la politique extérieure de Trump amplifiera dans la région. Le scandale diplomatique du 26 janvier n’en a été qu’une première illustration.
Sur le plan national, le Palacio Nariño a été secoué par une tornade politico-médiatique, qui a failli se solder par la constitution d’une diplomatie parallèle constituée des leaders de la droite. Sur la scène internationale, le sommet de la Celac (Communauté des États latino-américains et caribéens) qui devait se tenir le jeudi 30 janvier fut annulé en dernière minute par le pays-hôte, le Honduras, prétextant des désaccords sur… les politiques d’expulsion. Le séisme du 26 janvier n’aura décidément pas fait trembler que Bogotá.![]()
Hugo Corten ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.
















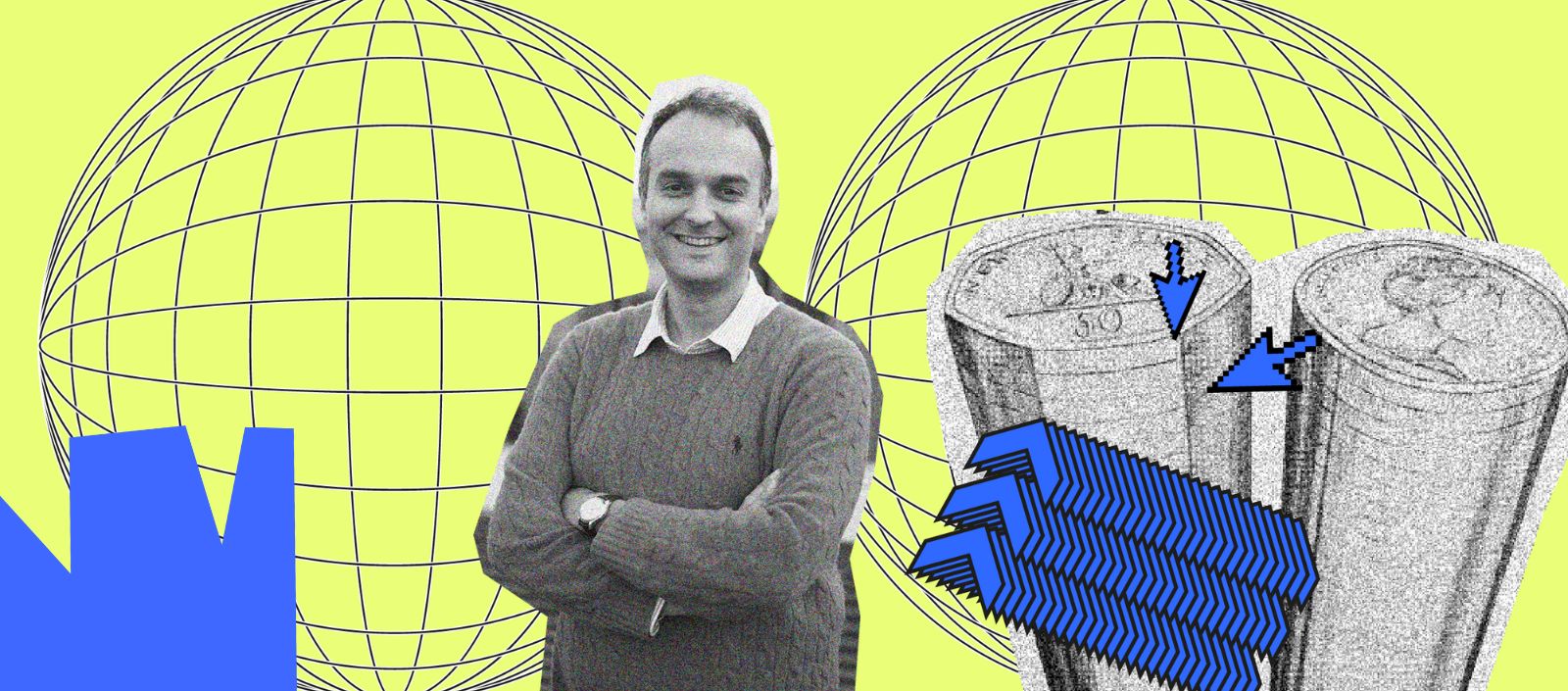



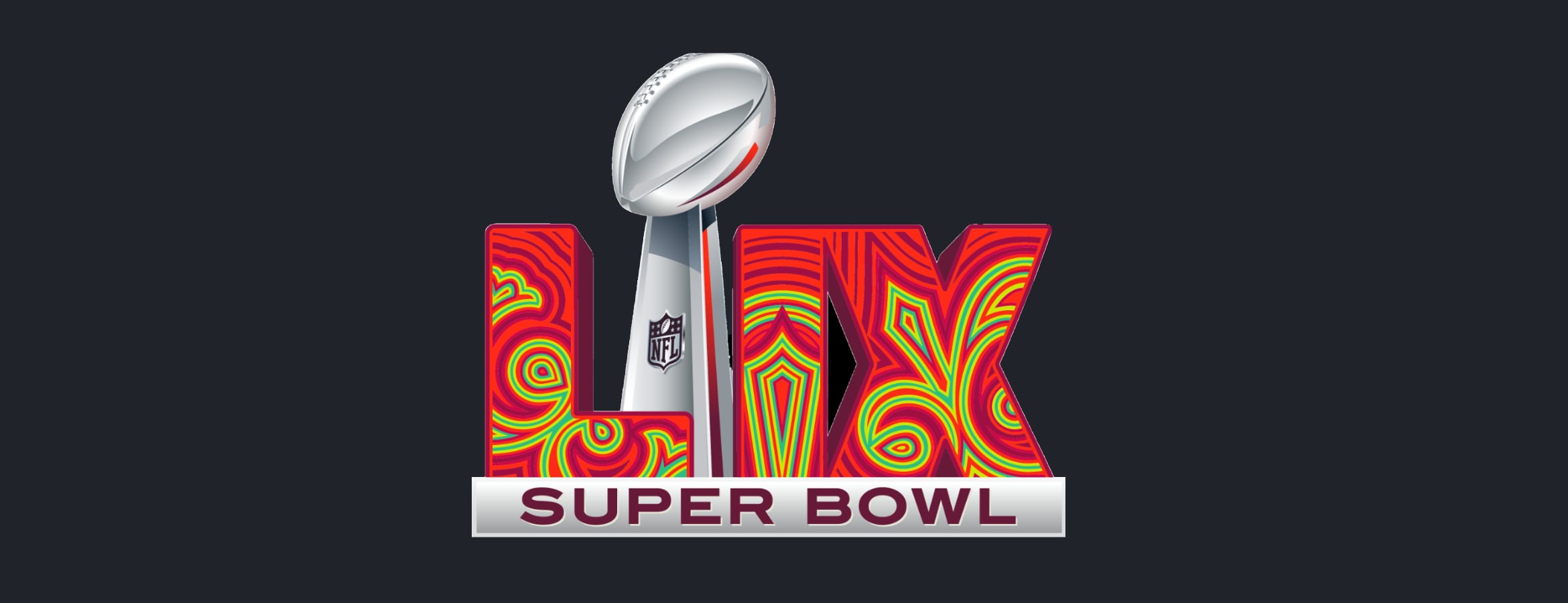












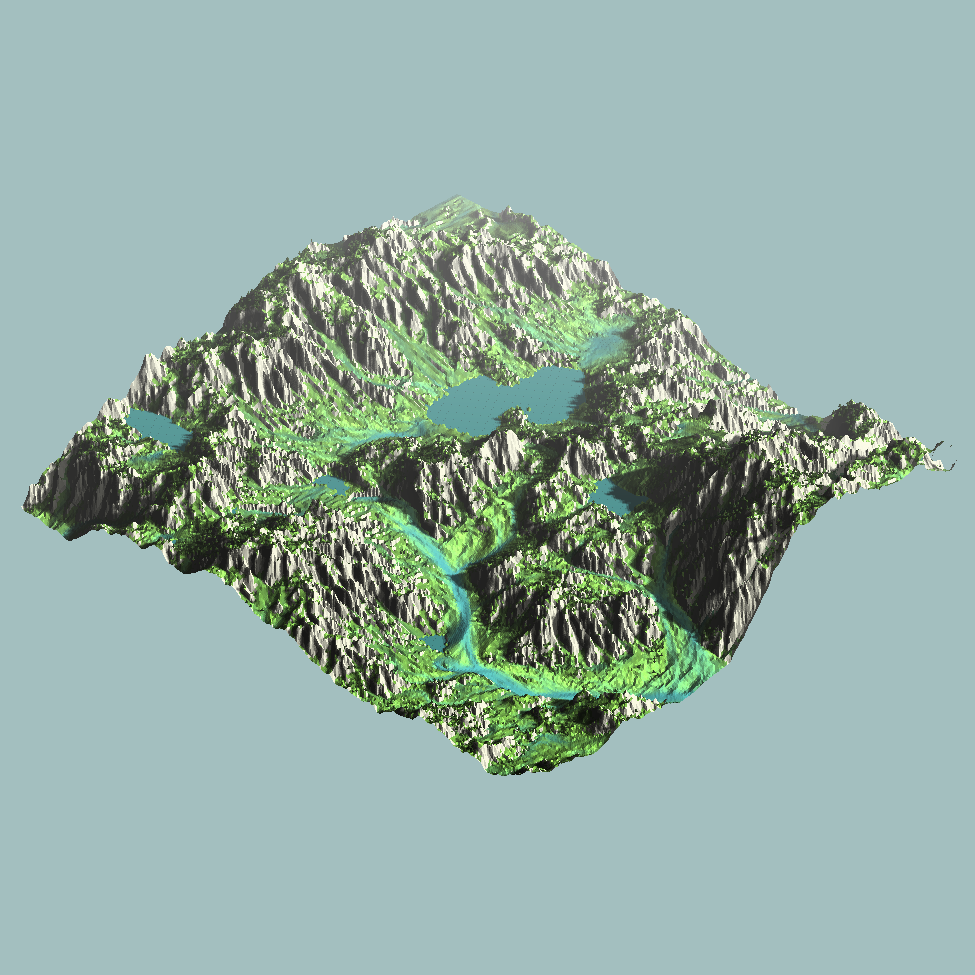
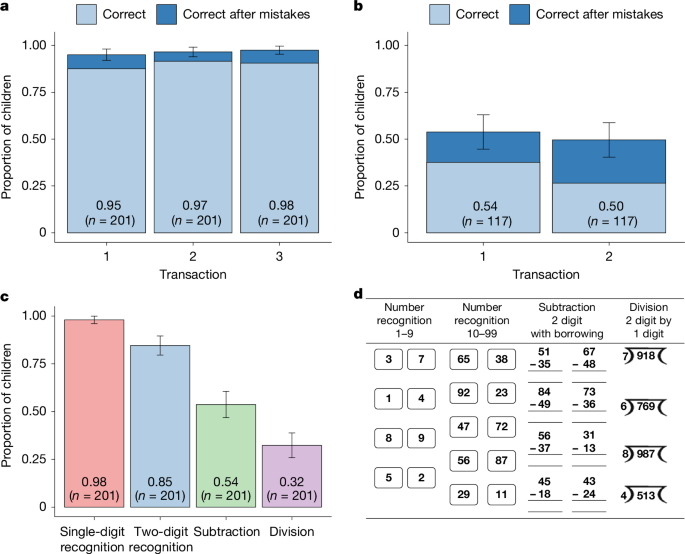







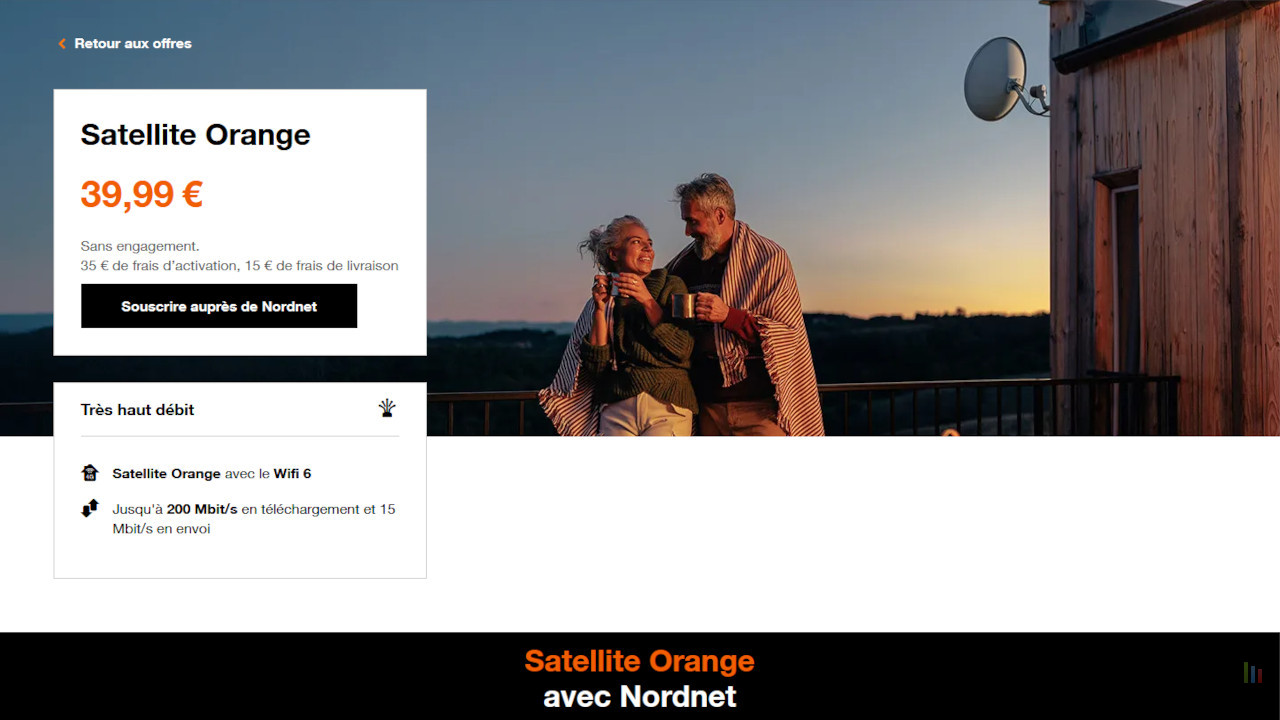
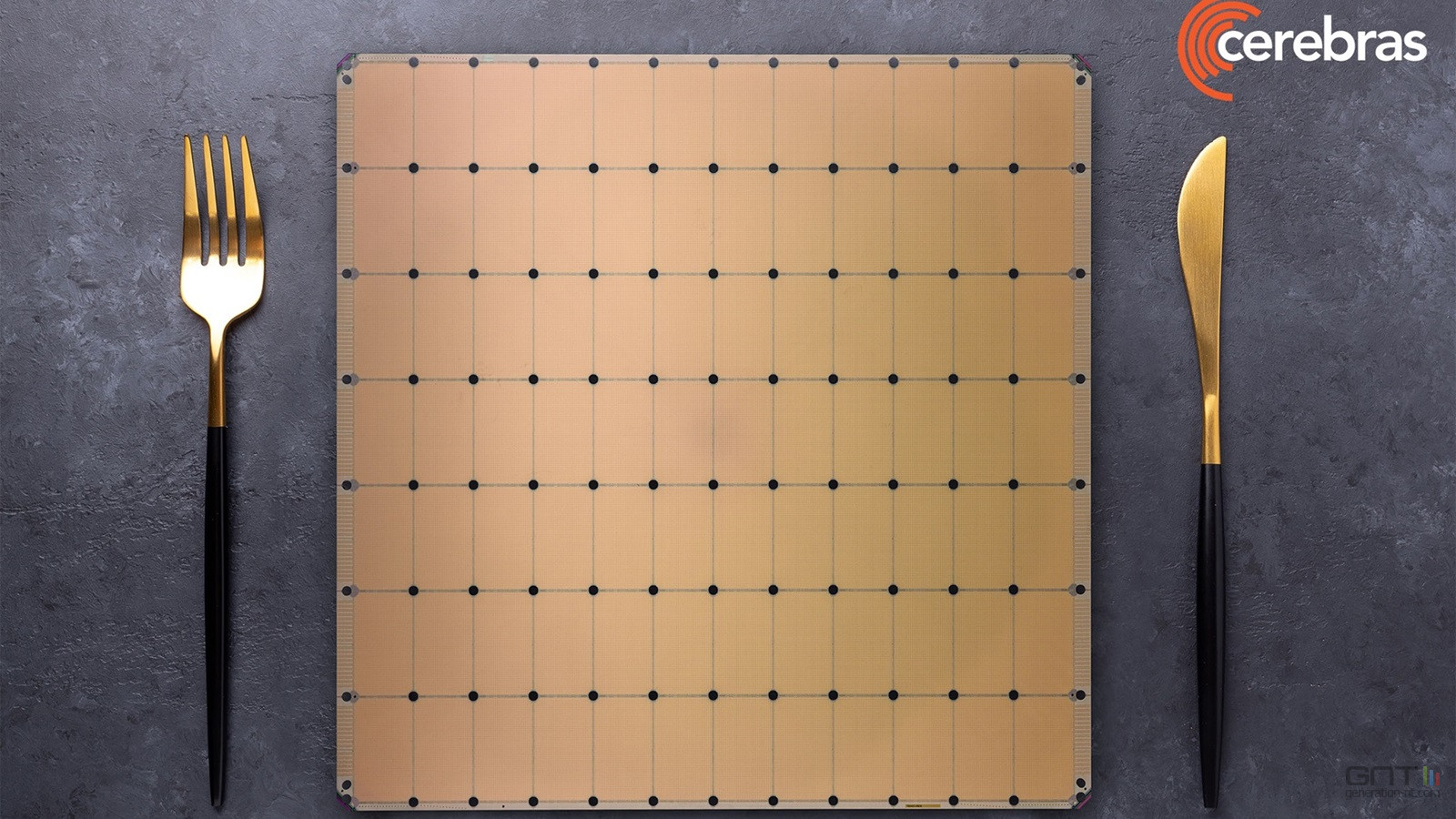




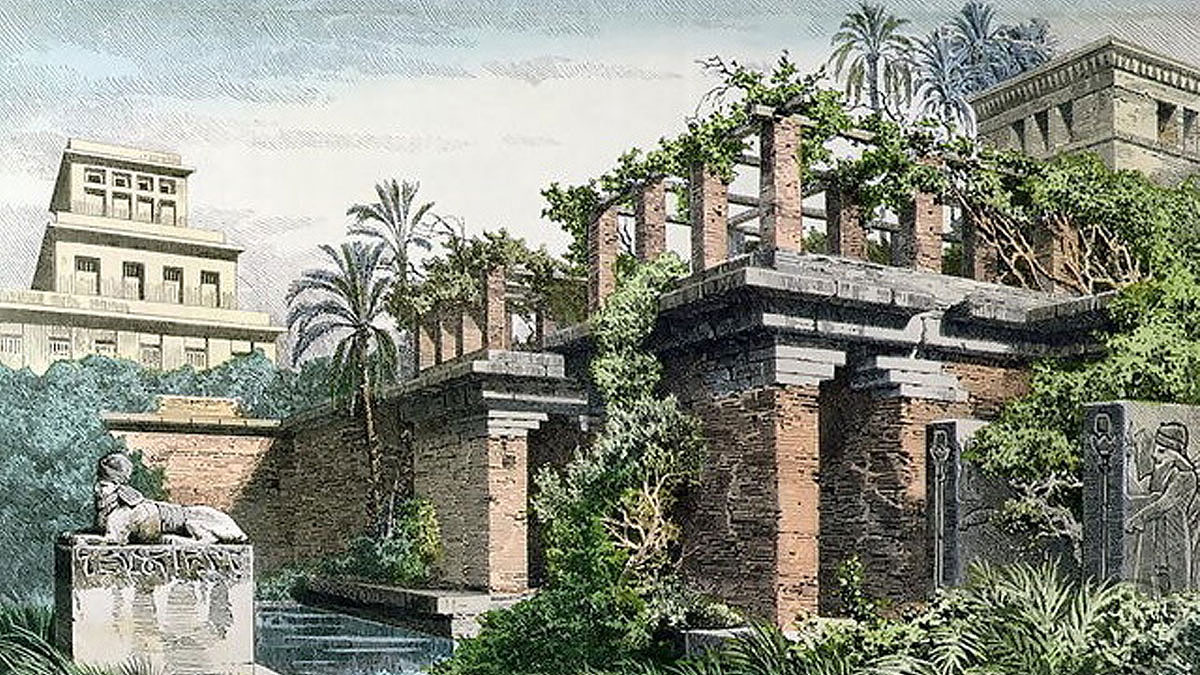
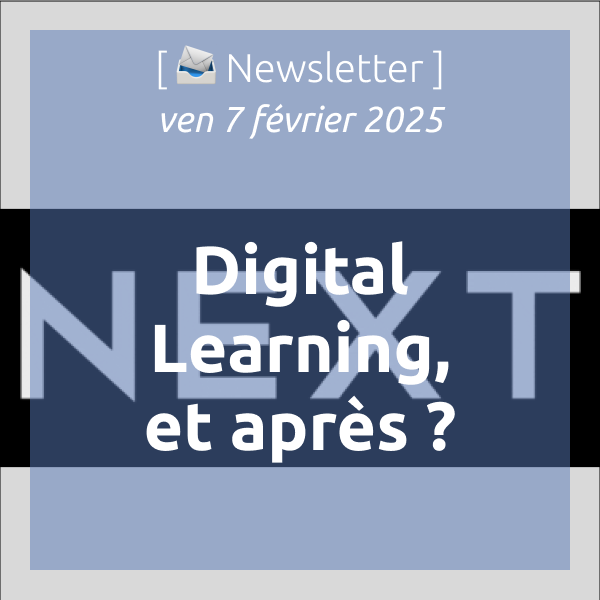
![Les batteries françaises dopées par la réserve secondaire [compte-rendu]](https://www.greenunivers.com/wp-content/uploads/2023/07/14-1024x576.png)
![Les flexibilités à la recherche de l’équilibre offre-demande [compte-rendu]](https://www.greenunivers.com/wp-content/uploads/2025/02/image-8.png)
![La consommation d’électricité en légère hausse en 2024 [RTE]](https://www.greenunivers.com/wp-content/uploads/2025/02/light-bulb-1867166_1280.jpg)