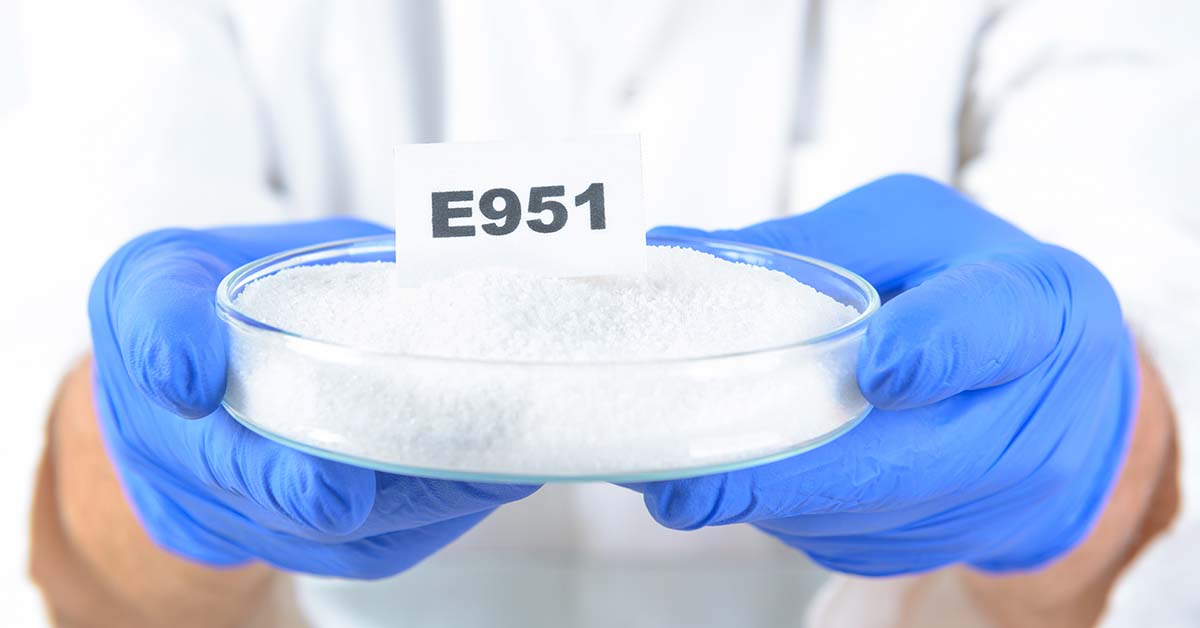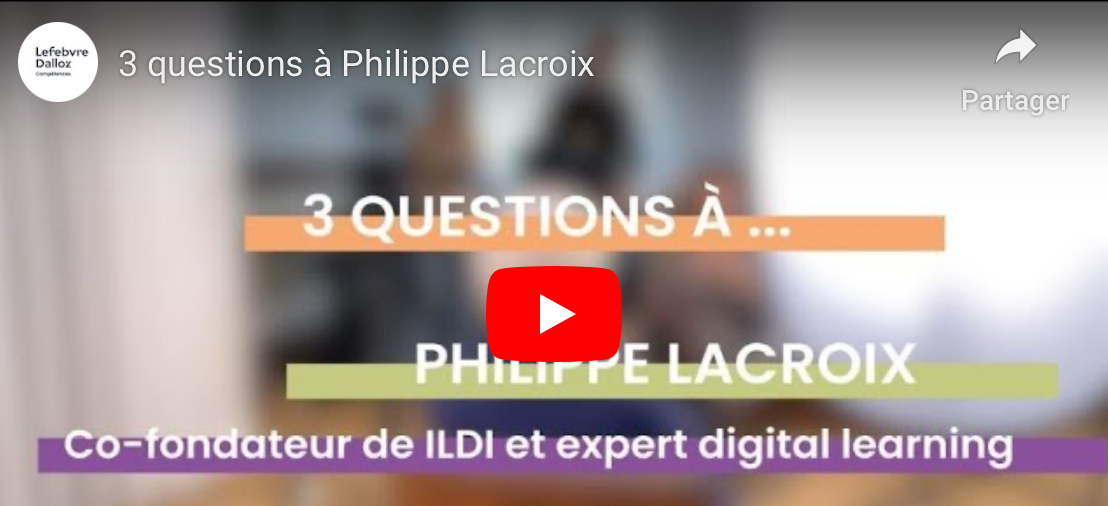Restreindre le droit du sol à Mayotte : une proposition inefficace
Jeudi 6 février, les députés examinent une proposition de loi du groupe Droite républicaine visant à restreindre encore un peu plus le droit du sol à Mayotte.

Dans le cadre de la « niche » parlementaire réservée au groupe Droite républicaine, les députés examinent ce jeudi 6 février une proposition de loi visant à restreindre encore un peu plus le droit du sol à Mayotte. Si elle devait être adoptée, il est peu probable que cette réforme change la donne en matière d’immigration irrégulière dans la région.
Seulement quelques jours après le passage du cyclone Chido qui a dévasté Mayotte, le ministre de l’intérieur Bruno Retailleau, issu des rangs du parti Les Républicains (LR), a évoqué la nécessité de « traiter la question migratoire » dans l’archipel et a ainsi remis sur la table la question du droit du sol.
Depuis 2018, une dérogation du droit du sol restreint la possibilité de devenir Français pour les enfants nés à Mayotte. Un enfant né de parents étrangers peut devenir français à sa majorité (ou par déclaration anticipée à partir de ses 13 ans) si au moins l’un de ses parents résidait légalement en France au moment de sa naissance depuis au moins trois mois.
Mercredi 29 janvier, les députés ont adopté en commission une proposition de loi des LR visant à durcir cette règle en exigeant que les deux parents aient résidé de manière légale et ininterrompue à Mayotte au moins un an avant la naissance de l’enfant. Le texte doit maintenant être examiné par l’ensemble des députés jeudi 6 février.
Cette proposition se distingue de celle avancée par Emmanuel Macron au début de l’année 2024 qui prévoyait la suppression complète du droit du sol à Mayotte et qui aurait nécessité une réforme constitutionnelle. Selon le président du groupe Droite républicaine Laurent Wauquiez, cette nouvelle proposition a « vocation à être étendue sur l’ensemble du territoire français. »
À lire aussi : Nouvelle crispation entre les Comores et la France à propos des migrants, 50 ans après l’indépendance
La réforme de 2018 n’a produit aucun effet visible sur l’immigration irrégulière
Pourtant, si elle devait être adoptée, il est peu probable que cette réforme change la donne en matière d’immigration irrégulière.
D’abord, la législation actuelle en matière de droit du sol est déjà plus stricte à Mayotte que dans le reste du territoire français. Cette spécificité résulte d’une réforme en 2018 dans le cadre de la loi Asile et immigration, qui a introduit la condition de résidence légale de trois mois au moins de l’un des parents pour que l’enfant puisse bénéficier un jour du droit du sol.
Cette réforme avait déjà pour objectif de répondre à « l’insoutenabilité de la pression migratoire pour les Mahorais », selon son promoteur Thani Mohamed Soilihi, à l’époque sénateur de Mayotte et actuellement ministre délégué à la Francophonie. Comme pour la réforme proposée aujourd’hui, l’argument avancé était que le droit du sol constituait un facteur d’attraction pour les migrations irrégulières, en incitant les accouchements à Mayotte.
Cependant, la migration irrégulière vers Mayotte repose sur de nombreux autres facteurs, notamment économiques, familiaux et sanitaires, qui ne sont pas liés au droit du sol. Par ailleurs, selon les statistiques d’état civil de l’Insee, il apparaît clairement qu’il n’y a pas eu de baisse du nombre de naissances issues de parents étrangers à Mayotte depuis la réforme de 2018. Plus de 8 000 nouveau-nés à Mayotte avaient une mère étrangère en 2022, un chiffre en hausse de 14 % par rapport à 2018 et cette augmentation n’est pas liée à une poussée démographique aux Comores.
Thani Mohamed Soilihi reconnaît d’ailleurs aujourd’hui que la modification du droit du sol n’est pas la solution miracle pour lutter contre l’immigration irrégulière.
De plus, il serait surprenant qu’un durcissement supplémentaire du droit du sol, voire sa suppression, réduise de façon tangible l’immigration irrégulière ou le nombre de naissances à Mayotte. Les dispositions de la réforme de 2018 ont déjà pour effet qu’au moins 55 % des naissances à Mayotte ne sont plus éligibles à l’acquisition de la nationalité française.
Toute réforme visant à durcir davantage encore les conditions d’obtention de la nationalité française ne concernerait donc, par définition, qu’une minorité des enfants nés de parents étrangers.
Les Comoriens fuient la misère
Le droit du sol n’est qu’un facteur secondaire de la pression migratoire à Mayotte.
La majorité des migrants viennent des îles comoriennes voisines, où le PIB par habitant est onze fois plus faible et les infrastructures sanitaires défaillantes : la mortalité maternelle y est douze fois plus élevée qu’à Mayotte, et la mortalité infantile quatre fois supérieure. Dans ce contexte, il n’est pas surprenant que de nombreux Comoriens tentent leur chance à Mayotte.
La mobilité entre les îles des Comores est une réalité qu’aucune politique restrictive ne pourra effacer. L’instauration du visa Balladur en 1995 a mis fin à la libre circulation entre les Comores et Mayotte, mais elle n’a pas empêché les migrations : elle les a rendues plus dangereuses et coûteuses, favorisant l’émergence de routes irrégulières.
Aujourd’hui, la politique migratoire repose essentiellement sur des expulsions massives et la précarisation juridique et sociale des migrants, ce qui a participé à aggraver le bilan tragique du cyclone Chido.
Repenser la politique migratoire dans la région
Cette politique produit en outre des effets pervers rarement discutés : d’une part, elle tend à « fixer » les migrants à Mayotte au lieu d’encourager les allers-retours, car certains préfèrent rester à Mayotte de peur de ne plus pouvoir y revenir ; d’autre part, elle crée de nombreux mineurs isolés suite à l’expulsion de leurs parents. Ces enfants sont difficiles à recenser, mais les associations et pouvoirs publics estiment qu’ils seraient entre 3 000 et 4 000 à Mayotte, et ils sont souvent accusés d’être l’une des sources de la violence que connaît l’île.
Il est crucial d’envisager une voie plus réaliste et mieux adaptée aux dynamiques de l’archipel. Cela passe évidemment par un renforcement des infrastructures sanitaires pour trouver des solutions aux graves problèmes de santé publique auxquels est confrontée la population comorienne. Il serait aussi pertinent de mettre en place un nouveau cadre migratoire qui favorise des déplacements sûrs et encourage les allers-retours, à l’image de ce qui existe ailleurs.
C’est le modèle adopté notamment entre Singapour et la Malaisie, où les écarts de richesses sont également considérables – le PIB par habitant de Singapour est près de sept fois supérieur à celui de la Malaisie – et où 80 000 travailleurs malaisiens peu qualifiés traversent quotidiennement la frontière pour travailler à Singapour grâce à des visas de travail spéciaux, des contrôles douaniers allégés, et un système de transport efficace.
Plus près de chez nous, les migrations pendulaires entre la France et la Suisse ou le Luxembourg sont courantes, avec chaque jour de nombreux Français qui traversent la frontière pour travailler dans ces pays voisins.
Accepter que Mayotte et les Comores sont des voisins, et non des adversaires, ouvrirait la voie à une gestion plus fluide et humaine des mobilités, tout en contribuant à répondre aux enjeux économiques et sociaux considérables auxquels ces territoires sont confrontés.![]()
Jules Gazeaud ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

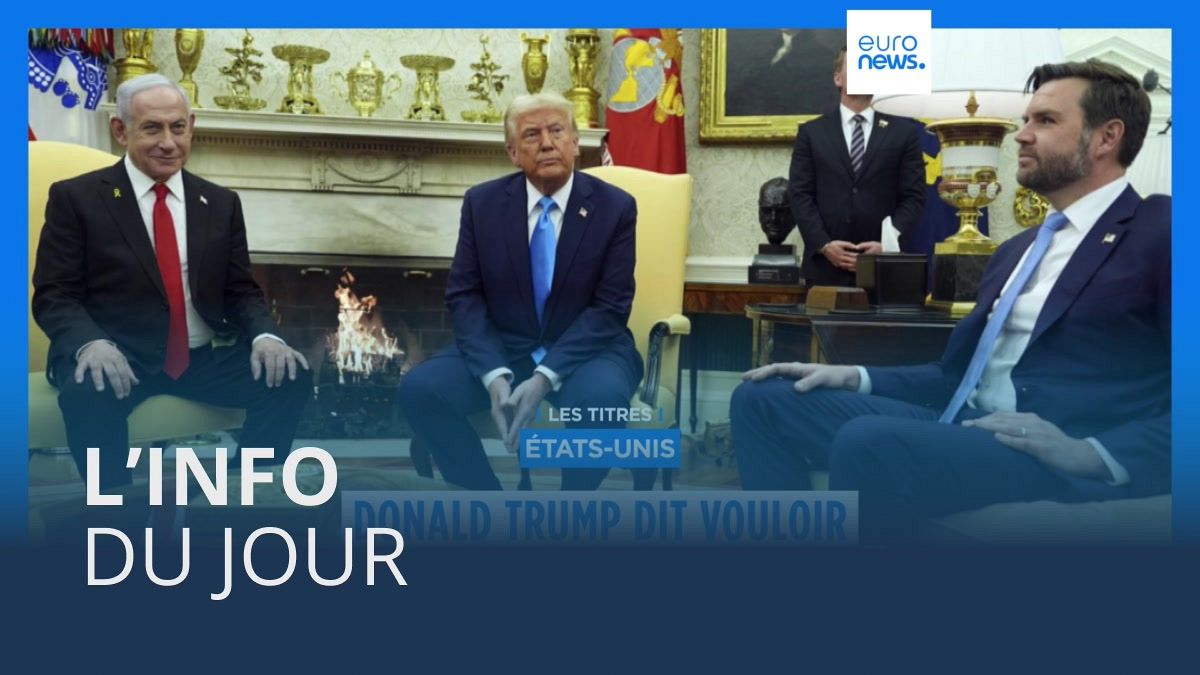



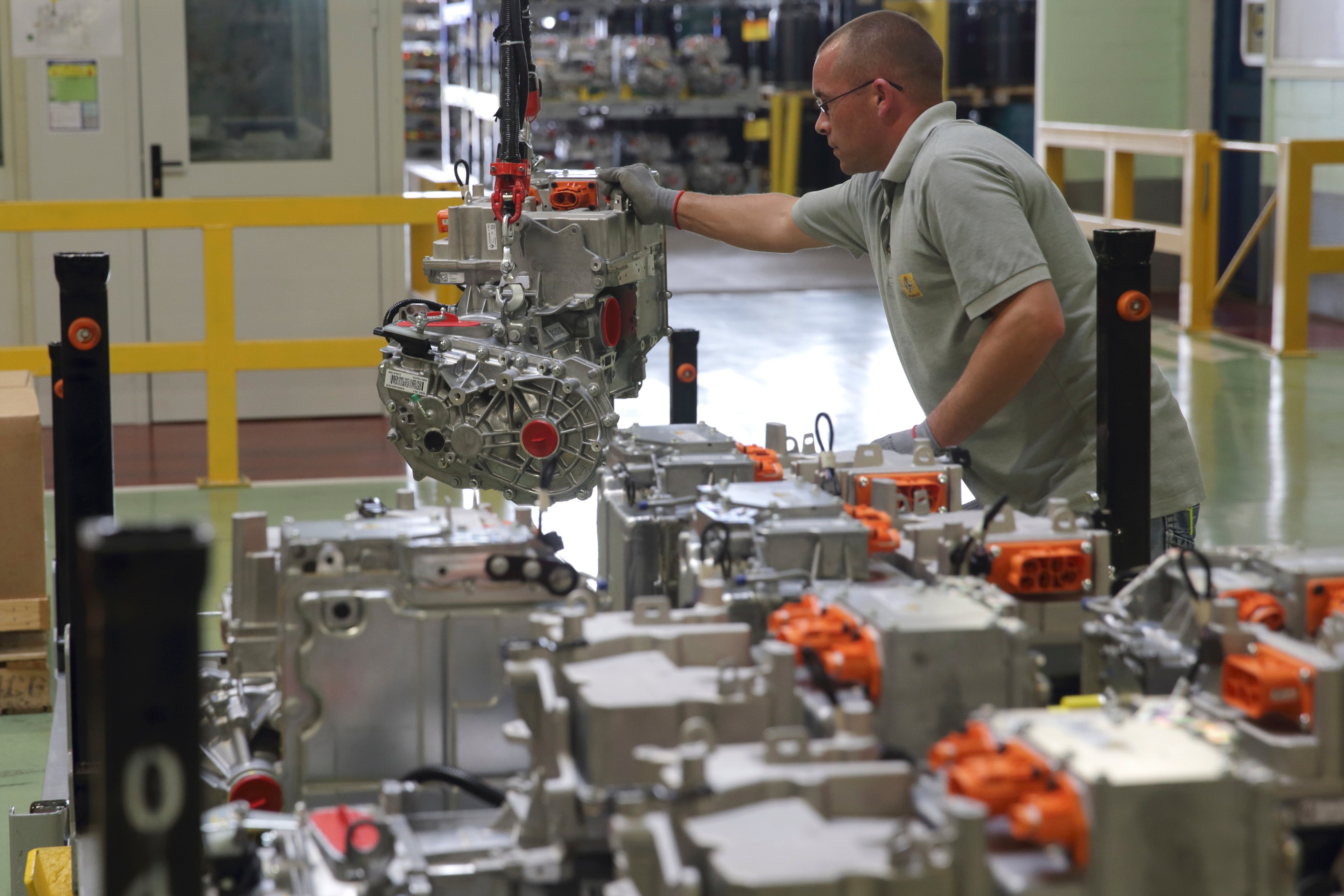



![[CHRONIQUE] Soixante ans de laxisme migratoire : le grand effacement ?](https://media.bvoltaire.fr/file/Bvoltaire/2025/01/melenchon-616x346.png?#)















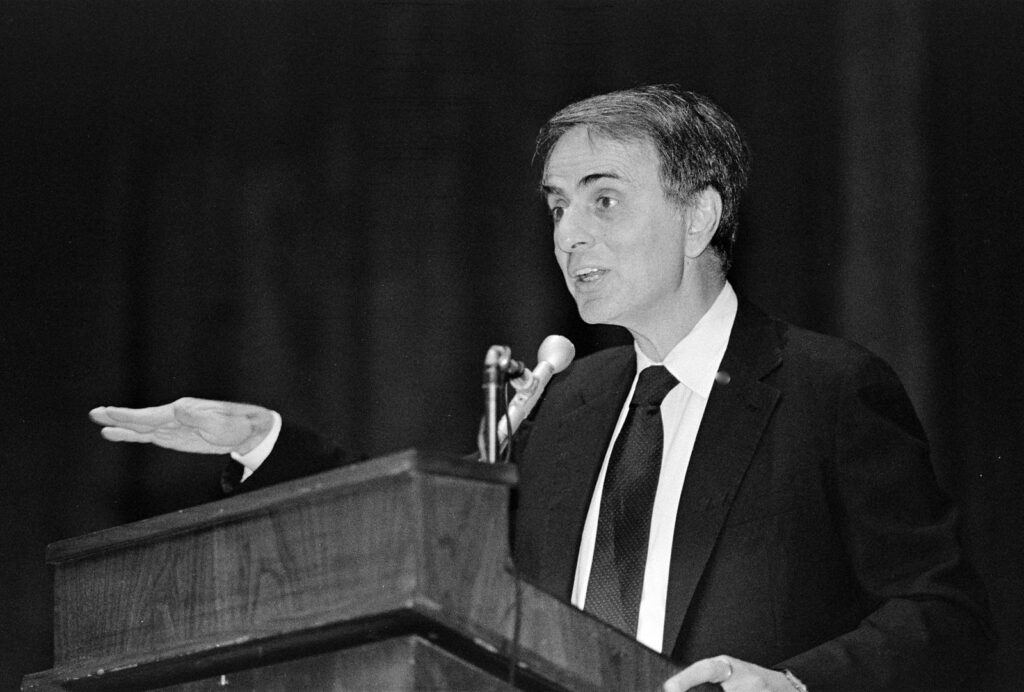



.jpg)







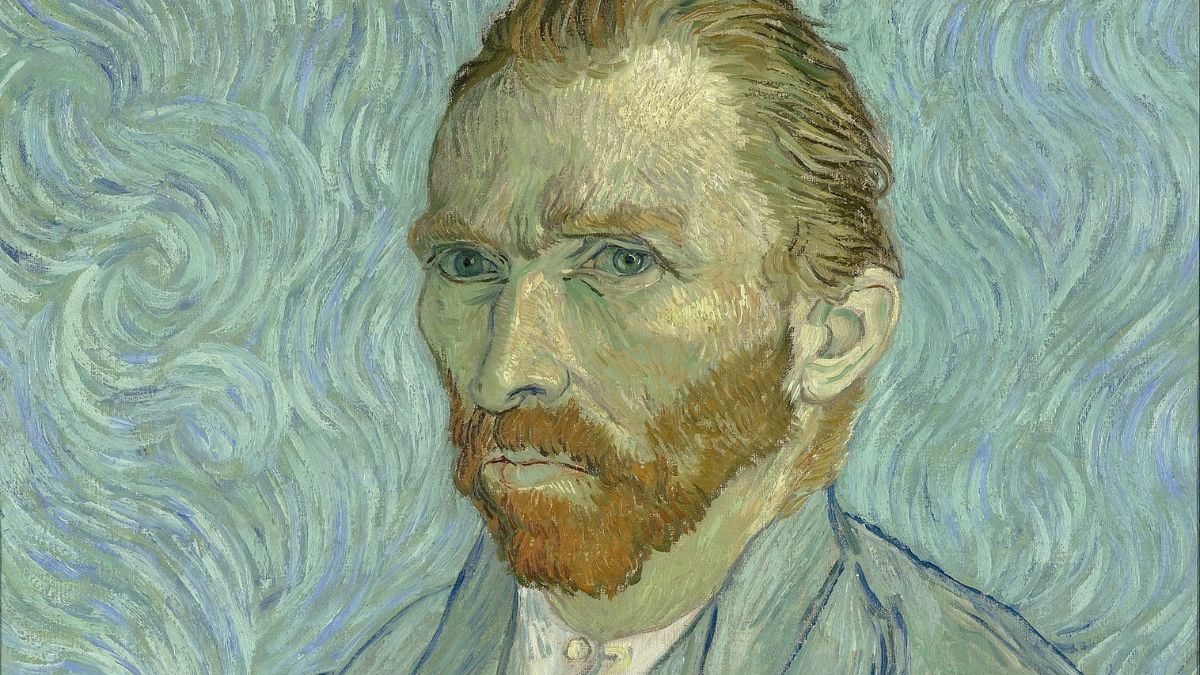
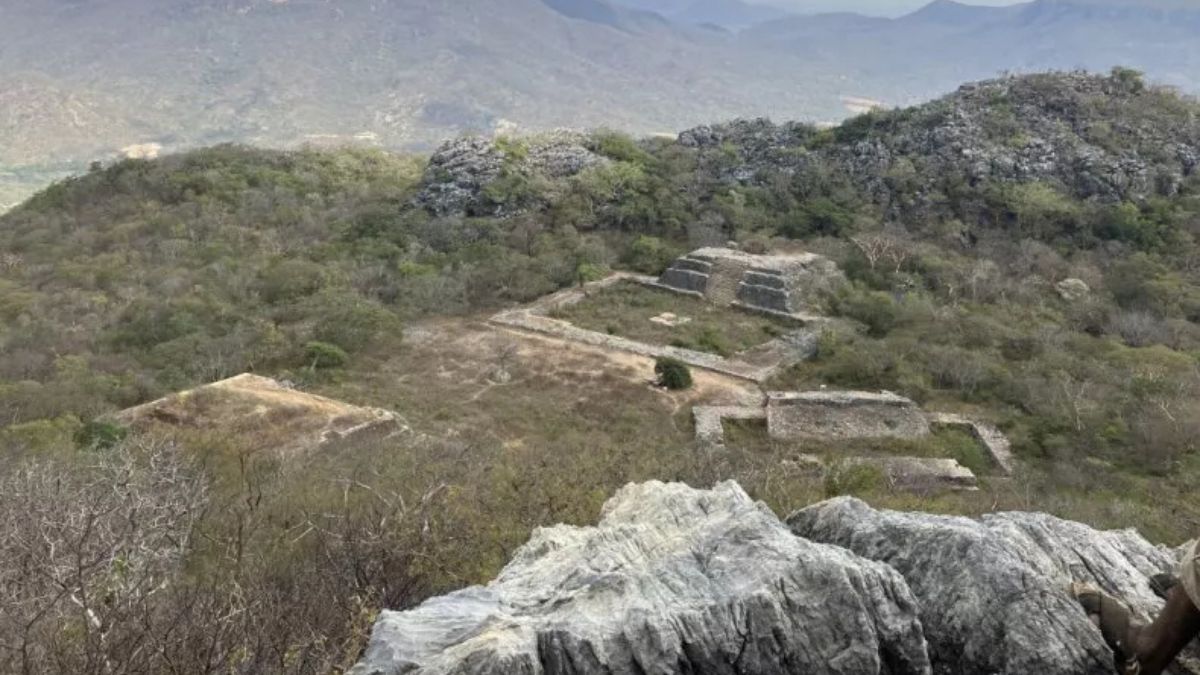








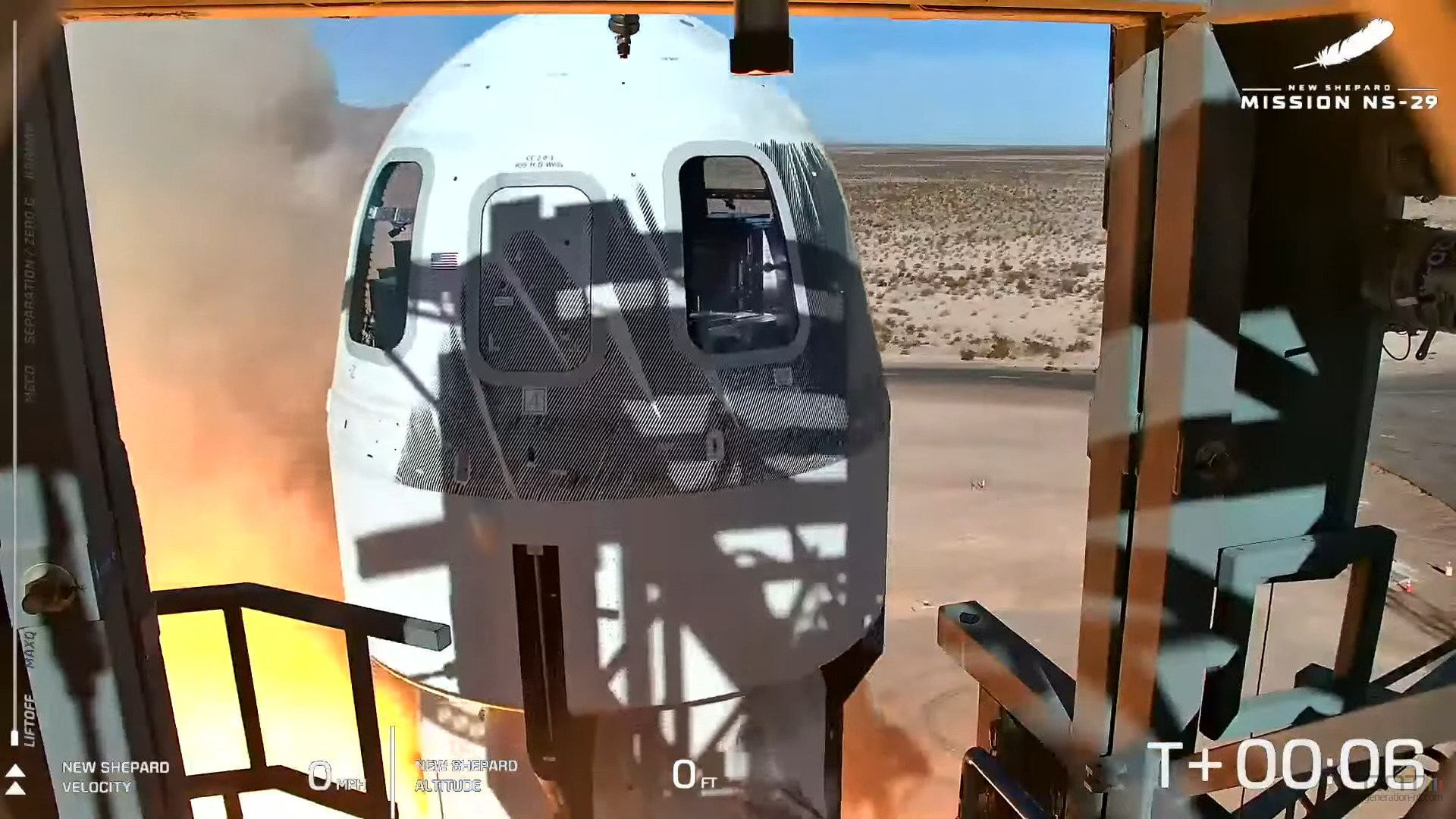

![« L’hydrogène européen commence à décrocher » [EY]](https://www.greenunivers.com/wp-content/uploads/2023/07/5-1024x576.png)