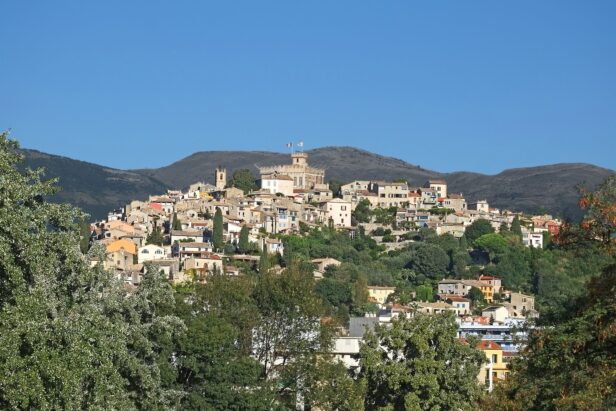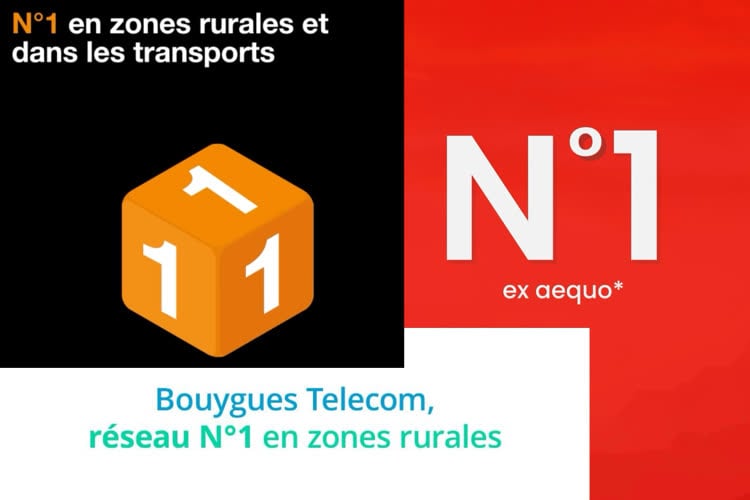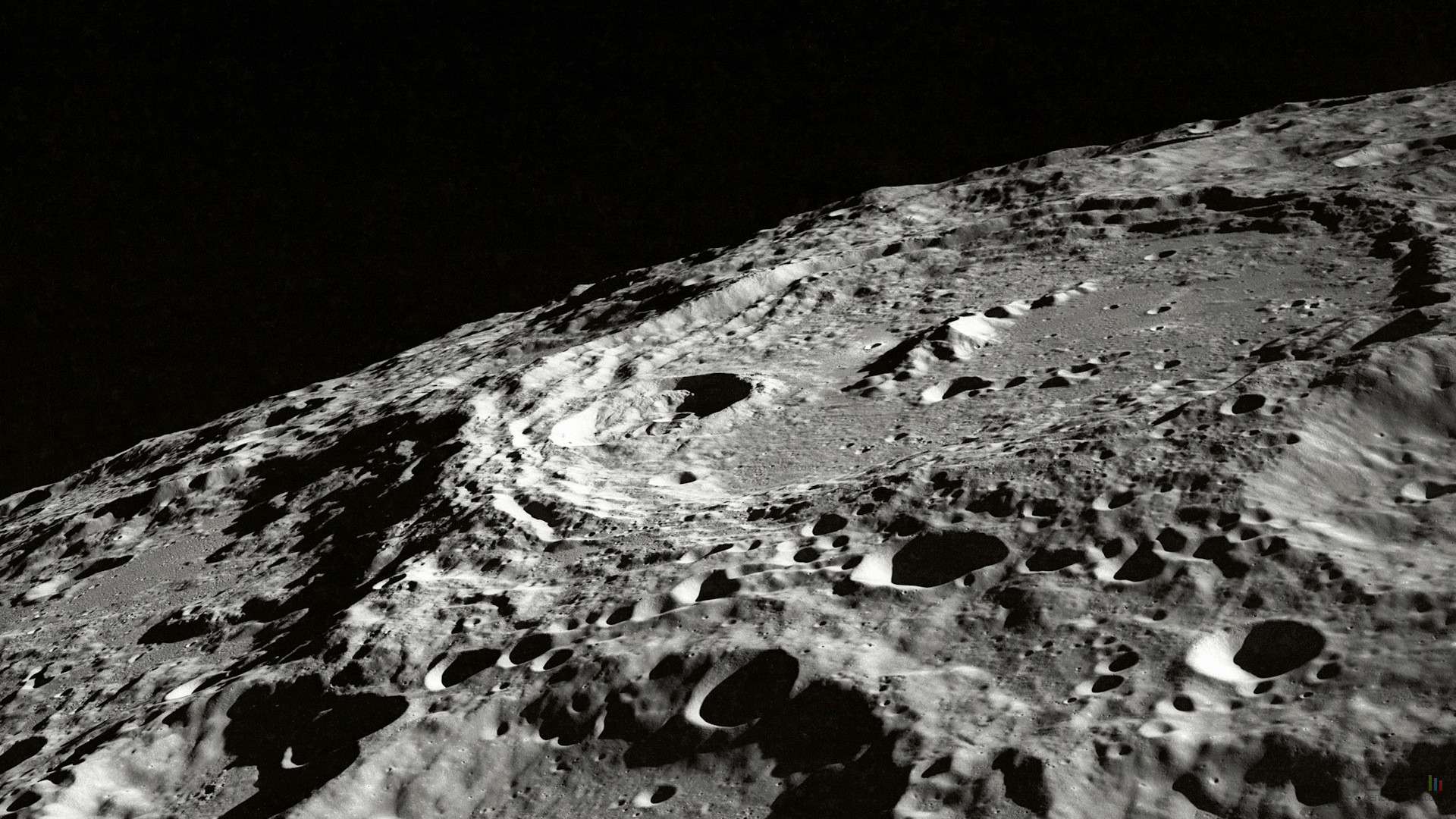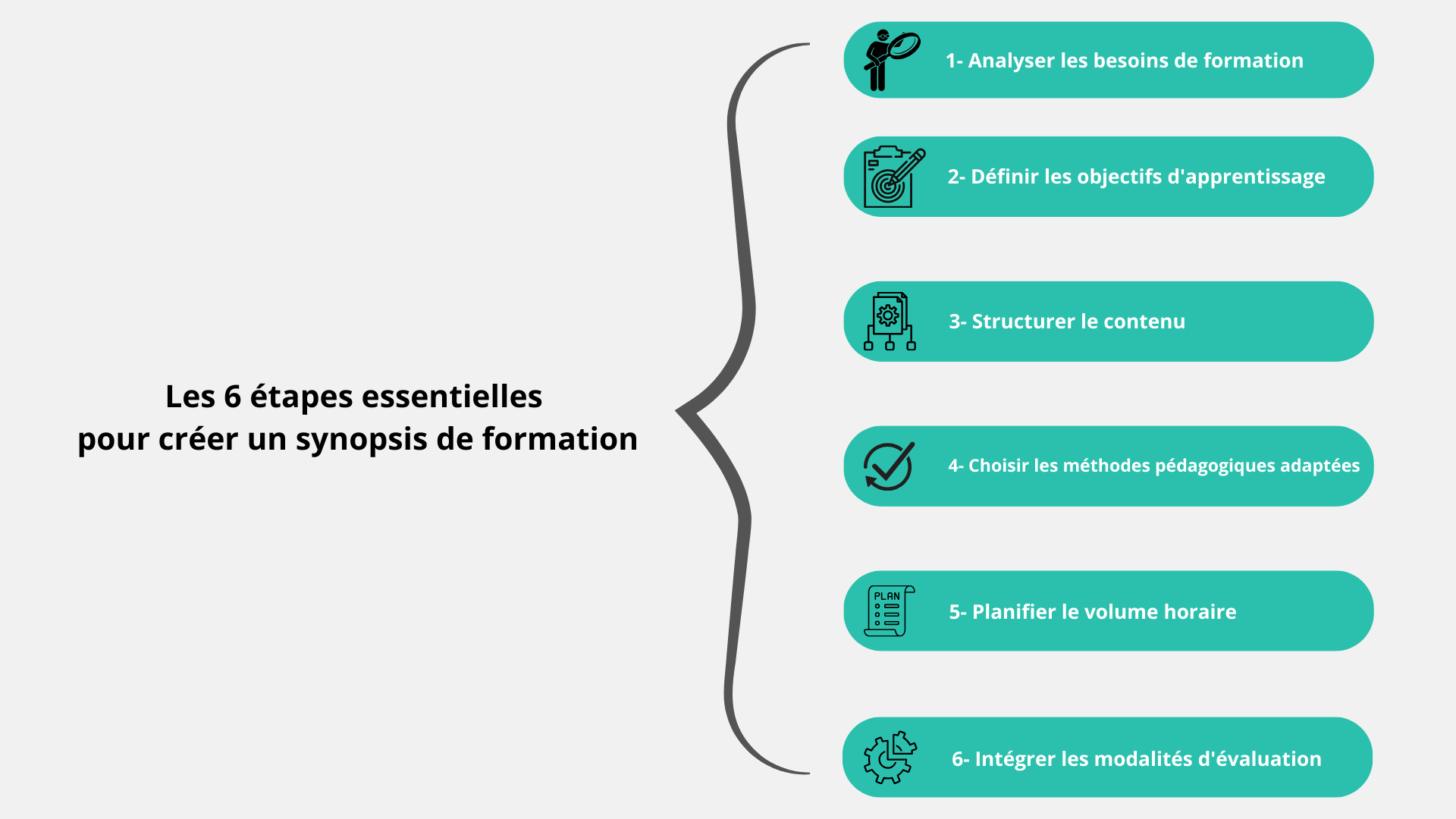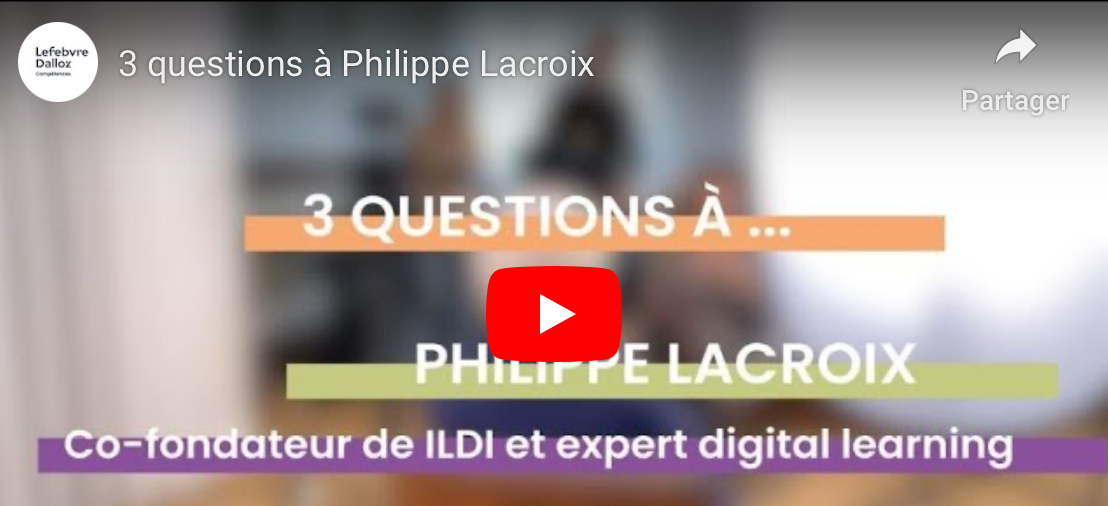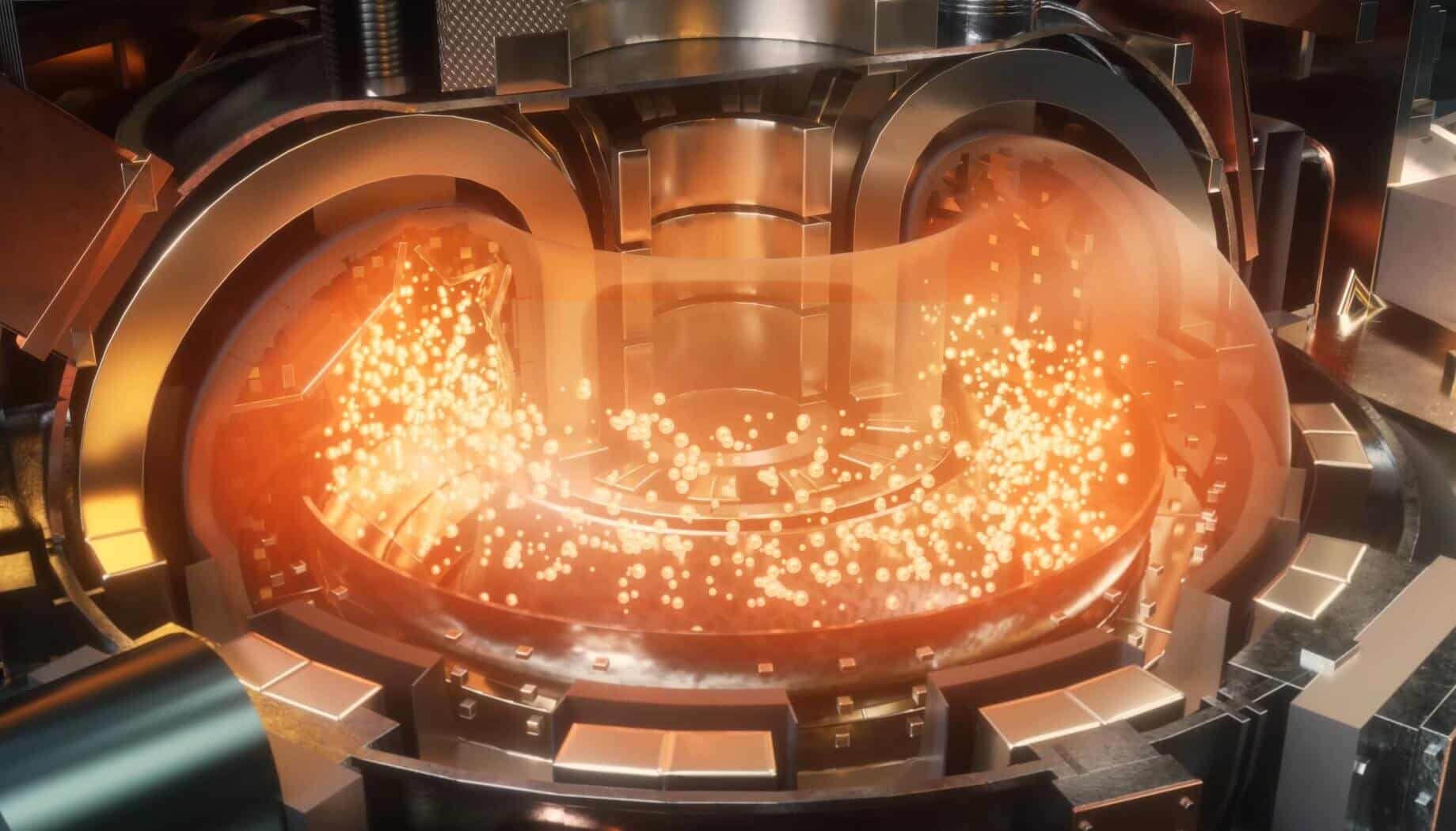Le déclin de la population chinoise est-il inéluctable ?
Malgré les décisions politiques du gouvernement chinois, la natalité reste faible, très faible. C’est que la natalité obéit à une pluralité de facteurs. Un décret, fût-il chinois, ne suffit pas.

Les politiques antinatalistes mises en œuvre en Chine pendant 50 ans ont laissé des traces et le gouvernement chinois peine aujourd’hui à relancer la natalité. Le déclin de la population chinoise s’accélère.
Depuis trois ans, la population chinoise diminue, ce qui constitue une première depuis la Grande Famine de 1958-1961. Selon le dernier recensement, elle est passée de 1 413 milliard en 2021 à 1 408 milliard en 2024. Cette baisse s’explique par un taux de fécondité extrêmement faible, bien en dessous du seuil de renouvellement des générations depuis plusieurs décennies.
Les projections des Nations unies estiment que la population chinoise pourrait passer sous la barre du milliard d’ici à 2070, et perdre entre 500 et 800 millions d’habitants d’ici à la fin du XXIe siècle selon les scénarios. Avec un solde migratoire négligeable, un vieillissement accéléré et un déséquilibre entre le nombre d’hommes et de femmes lié à la préférence pour les naissances de garçons sous la politique de l’enfant unique, la situation démographique en Chine suscite bien des inquiétudes.
Les autorités chinoises craignent les conséquences économiques et sociales du déclin démographique, d’autant plus que, contrairement à l’Europe, la Chine a vieilli avant de devenir riche. Son PIB par habitant ne s’élève qu’à environ 40 % du PIB par habitant en France. La diminution de la population en âge de travailler pourrait entraver l’innovation, la productivité et la croissance, exacerber les pressions sur le système de protection sociale et, in fine, faire retomber dans la pauvreté une part substantielle de la population.
Comment en est-on arrivé là ?
La politique de l’enfant unique, instaurée en 1979, est souvent citée comme la principale cause de la faible natalité actuelle. Cependant, la baisse de la natalité avait déjà commencé quelques années plus tôt, sous l’effet d’une autre politique prônant des mariages tardifs, des naissances espacées et limitées, et qui, en pratique, instaurait un quota de deux enfants par femme. Ces mesures coercitives ont engendré une transition démographique rapide, mais elles ont aussi ancré durablement des choix de fécondité dépassant les objectifs initiaux et contribuant à une décroissance prolongée.
À lire aussi : Graphiquement vôtre : Le célibat masculin, un nouveau défi pour la Chine
Pour enrayer le déclin, la Chine a aboli la politique de l’enfant unique en octobre 2015 et a depuis progressivement autorisé deux, puis trois enfants par femme en 2021. Les dirigeants chinois s’attendaient à un baby-boom… qui n’a pas eu lieu. D’autres mesures ont également été mises en œuvre pour relancer la natalité : les incitations à retarder le mariage et la procréation ont été abandonnées, l’obligation de pratiquer la contraception levée, tandis que les échographies et avortements visant à sélectionner le sexe du fœtus ont été interdits, et la prise en charge de l’infertilité renforcée. Tout cela sans succès, puisqu’en 2024, le taux de fécondité est tombé à environ un enfant par femme, un record pour la Chine et l’un des plus bas au monde.
Le baby-boom n’a pas eu lieu
Pour expliquer pourquoi les couples chinois n’ont pas saisi l’opportunité d’avoir un deuxième enfant, les analystes évoquent souvent des raisons financières. Avoir un deuxième enfant coûterait trop cher : l’éducation, les activités extrascolaires, le logement, etc. Cependant, les dépenses consacrées aux enfants sont, dans une certaine mesure, un choix des parents. Pourquoi les parents chinois choisissent-ils aujourd’hui de dépenser autant d’argent par enfant, quitte à n’en avoir qu’un ?
Une hypothèse, peu explorée, repose sur l’idée d’un « piège de la faible natalité » (ou low fertility trap, en anglais). Ce piège repose principalement sur deux mécanismes. D’une part, le conformisme social incite les couples à adopter les normes affichées dans leur communauté : si la majorité a peu d’enfants et leur consacre non seulement un budget important mais aussi beaucoup de temps, cela devient le comportement attendu pour tous les autres.
D’autre part, la concurrence économique encourage les parents à limiter les naissances pour investir davantage dans l’éducation et le bien-être de chaque enfant : ils arbitrent en faveur de la « qualité » aux dépens de la quantité. Dans un contexte compétitif, les couples hésitent à avoir une famille nombreuse, de peur de ne pas pouvoir rivaliser en termes de ressources avec ceux ayant moins d’enfants. Ce sont notamment les femmes, sur lesquelles repose l’éducation des enfants, qui choisissent de ne pas avoir de deuxième enfant, voire « pas d’enfant du tout ».
Un effet d’imitation
Nos travaux avec Yun Xiao montrent que ces mécanismes ont historiquement accéléré la transition démographique en Chine en créant un effet d’entraînement (« spillover effect »). Dans les années 1970, nous estimons que les politiques de contrôle des naissances imposées aux Hans (le groupe ethnique majoritaire en Chine) ont réduit la fécondité moyenne de 0,8 enfant par femme. Les minorités ethniques, bien qu’elles ne soient pas soumises aux quotas, ont, elles aussi, réduit leur natalité en réponse au changement des comportements des Hans qui vivaient dans la même préfecture. Nos estimations prédisent qu’une femme donne naissance à 0,65 enfant de moins lorsque la fécondité moyenne de ses pairs diminue d’un enfant.
Ce piège n’est pas propre à la Chine. D’autres chercheurs ont étudié le cas de la Corée du Sud, où le taux de fécondité est encore plus bas qu’en Chine, avec moins de 0,8 enfant par femme. Dans ce pays, 75 % des enfants suivent des cours extrascolaires à des tarifs exorbitants, les hagwons, représentant en moyenne 9,2 % du revenu des ménages par enfant. Les auteurs montrent qu’une « externalité de statut » (« status externality » en anglais) joue un rôle central : les parents comparent leurs dépenses éducatives et le temps qu’ils consacrent aux devoirs de leurs enfants à ce que font les autres parents.
Cela alimente une compétition croissante pour offrir une éducation de qualité. Ce sont notamment les comportements éducatifs des ménages aisés qui influencent ceux des familles moins favorisées. Cette dynamique de comparaison sociale renforce les effets d’entraînement entre familles et pèse sur les décisions de fécondité. Si cette externalité disparaissait, c’est-à-dire si les parents cessaient de prendre en compte le comportement des autres, l’étude estime que la natalité sud-coréenne augmenterait de 28 %, repassant au-dessus d’un enfant par femme.
[Déjà plus de 120 000 abonnements aux newsletters The Conversation. Et vous ? Abonnez-vous aujourd’hui pour mieux comprendre les grands enjeux du monde.]
Que peut faire le gouvernement chinois ?
Les dynamiques sociales qui sous-tendent le piège de la faible natalité sont difficiles à inverser en raison du problème de coordination qu’elles génèrent. Tous les couples souhaiteraient réduire les ressources consacrées aux enfants, mais aucun d’entre eux n’a intérêt à être le premier à le faire. Ne pas inscrire son enfant à des cours de soutien, alors que tous les autres élèves y participent, le désavantagerait dans sa réussite scolaire. Le gouvernement chinois a tenté d’empêcher cette fuite en avant en interdisant les cours particuliers. Mais le marché noir s’est développé, et tant que la société restera compétitive, on peut penser que les familles chercheront de nouveaux moyens de se différencier.
En théorie, les effets d’entraînement que nous avons observés par le passé devraient également opérer dans le sens inverse : les couples pourraient avoir plus d’enfants s’ils observaient que leurs pairs en ont eux-mêmes davantage. Il faudrait alors stimuler les naissances dans les groupes influents et espérer une propagation aux autres couples. Cela pourrait passer par des mesures telles que les allocations familiales, des politiques scolaires avantageant les familles nombreuses, une meilleure gestion et rémunération des congés parentaux ou encore l’extension et la subvention des services de garde d’enfants. Cependant, il est par nature difficile de sortir d’un piège, et un rebond durable de la natalité parait peu probable dans les circonstances actuelles.![]()
Pauline Rossi est affiliée au Center for Economic Policy Research. Pauline Rossi a reçu des financements de European Research Council, Dutch Research Council, Templeton Foundation and Fidelity Charitable.








![[RÉACTION] « A Nice, la statue de Jeanne d’Arc restera ! »](https://media.bvoltaire.fr/file/Bvoltaire/2025/02/entretien-ecrit-vardon-720-616x347.jpg?#)