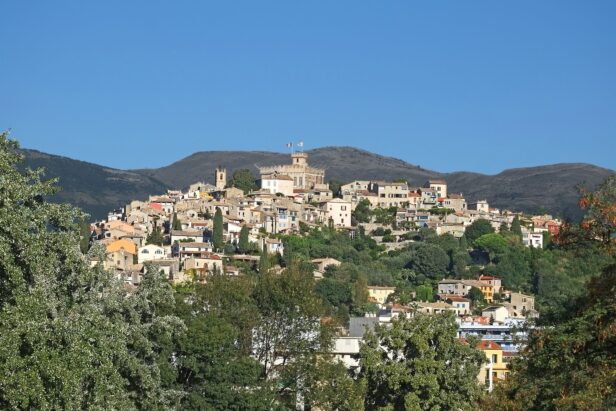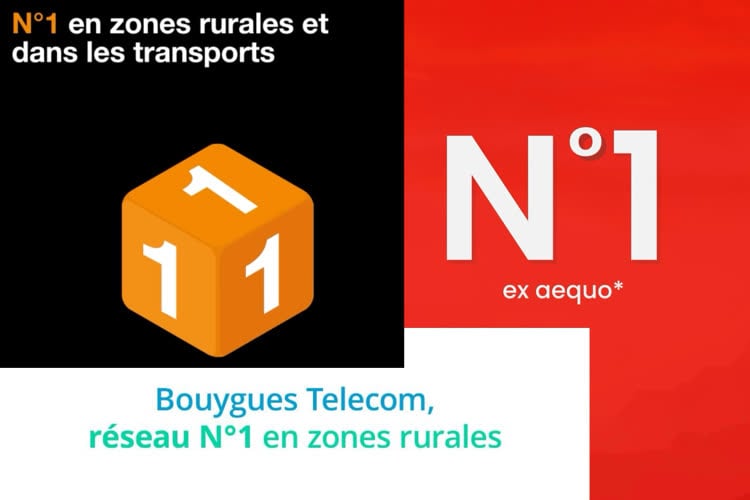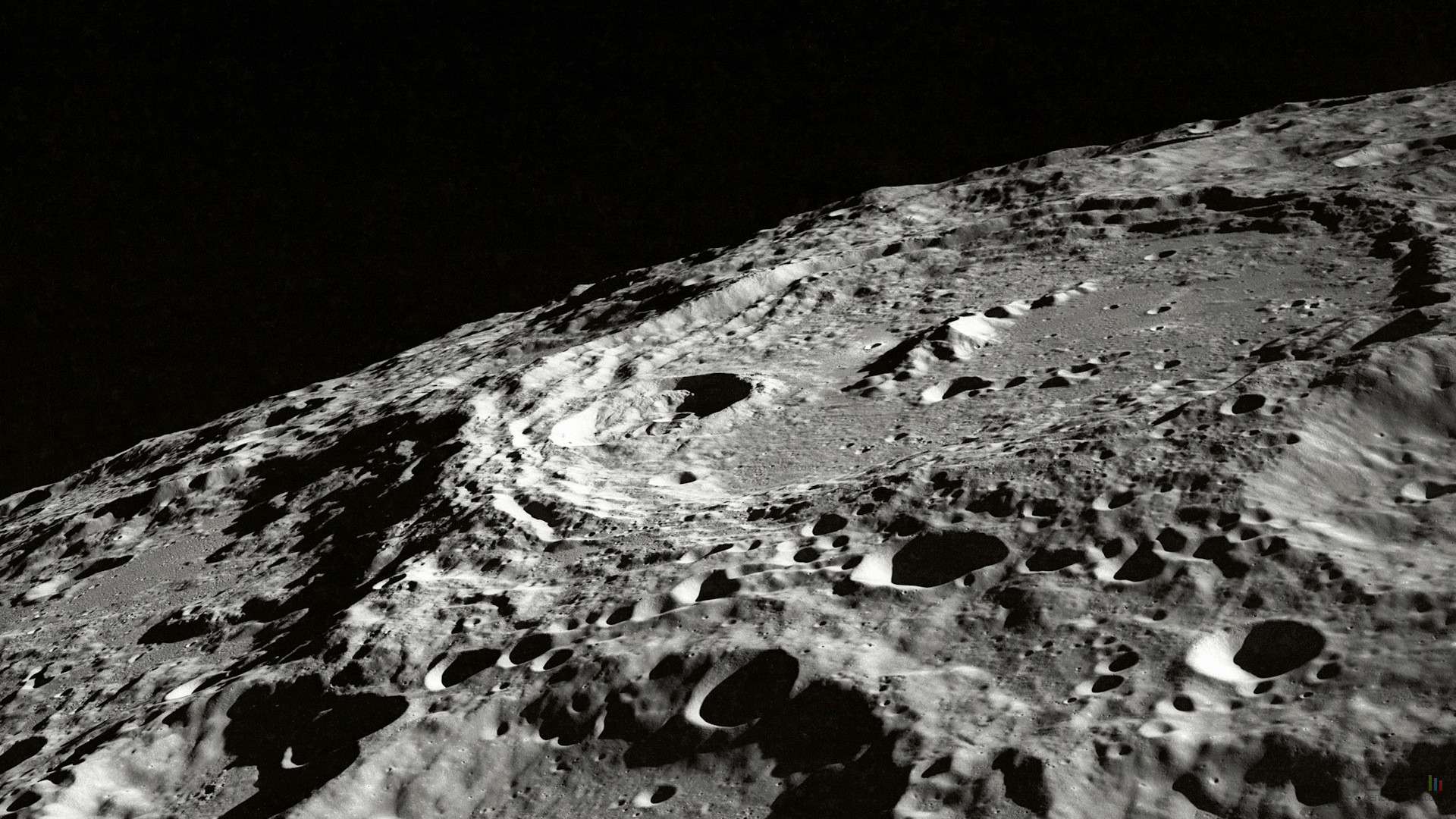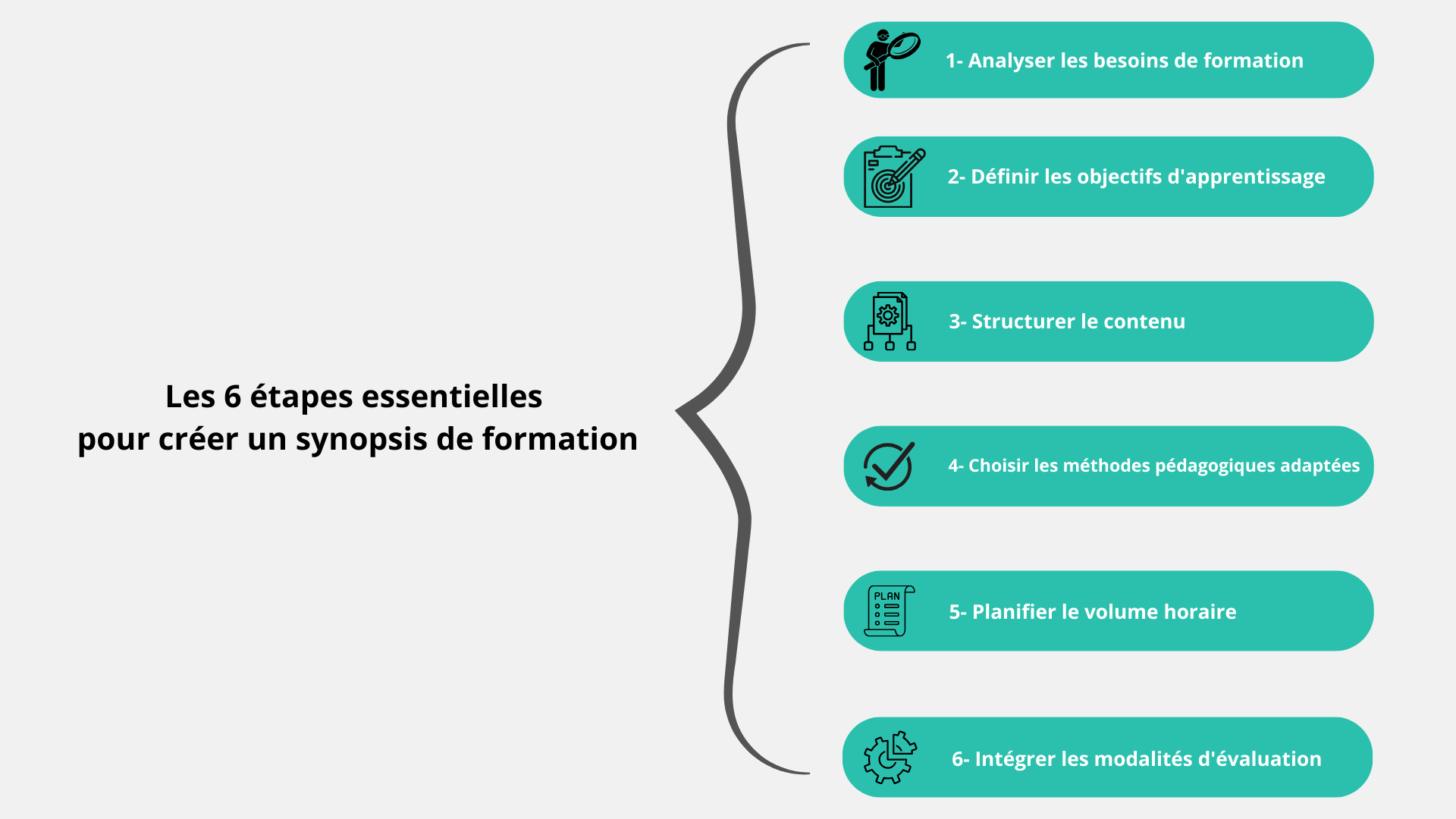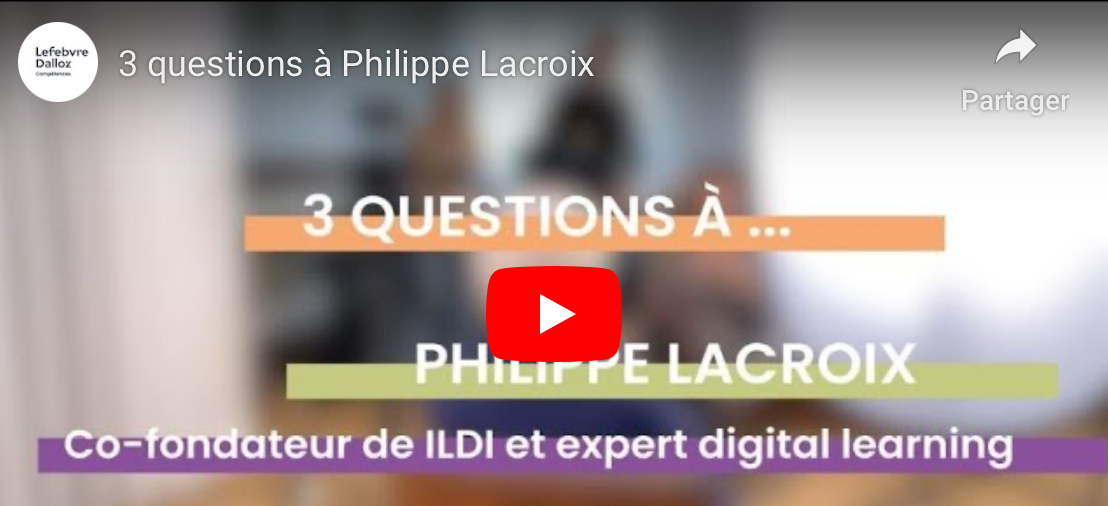Trump et la lutte contre les migrants : ce qu’il a fait, ce qu’il veut faire… et ce qu’il peut faire
Supprimer le droit du sol pour les enfants de migrants, expulser des millions de personnes, fermer les frontières… Autant de projets annoncés et, pour certains, déjà lancés, que le président aura du mal à mener à bien

Donald Trump a déjà signé plusieurs décrets visant à appliquer son programme extrêmement restrictif en matière d’immigration, qui comprend notamment « l’expulsion de millions de sans-papiers ». Dans les faits, il devrait, comme lors de son premier mandat, lorsqu’il promouvait déjà des mesures similaires, être rapidement confronté à la fois au coût économique et politique d’un tel projet et à la Constitution des États-Unis, dont certaines dispositions seront très difficiles à supprimer.
Quelques heures après son investiture, le président Donald Trump a signé une série de décrets visant à restreindre drastiquement l’entrée des migrants sur le territoire nord-américain et à expulser plusieurs millions de personnes déjà présentes aux États-Unis.
Six décrets exécutifs publiés le 20 janvier 2025 vont directement affecter la vie des migrants. L’objectif de chacun d’entre eux est exprimé dans leurs intitulés respectifs : protéger le peuple américain contre l’invasion ; garantir la protection des États contre l’invasion ; déclarer l’état d’urgence national à la frontière sud des États-Unis ; protéger les États-Unis contre les terroristes étrangers et d’autres menaces à la sécurité nationale et à la sûreté publique ; réorganiser le programme d’admission des réfugiés aux États-Unis ; protéger le sens et la valeur de la citoyenneté nord-américaine ; protéger le sens et la valeur de la citoyenneté nord-américaine.
Certains de ces décrets enfreignent le droit établi ; d’autres se révéleront pratiquement impossibles à mettre en œuvre au regard des ressources limitées dont dispose l’administration états-unienne et de l’absence de coopération des pays étrangers. Pourtant, Trump réussit parvient déjà à empêcher les demandeurs d’asile de se présenter à la frontière sud, et à instiller la peur chez les immigrants, y compris légaux, installés dans le pays.
Fermer la frontière sud
Dans ces décrets, Trump affirme que les États-Unis ont « subi une invasion de migrants à grande échelle », ce qui aurait créé une « urgence nationale à la frontière sud ». En vertu de l’article 212(f) de la loi sur l’immigration et la nationalité, il a décidé de « suspendre » l’entrée de toute personne « engagée dans l’invasion » des États-Unis.
Il est vrai que plus de deux millions de migrants sont arrivés à la frontière sud en 2022, et autant en 2023, certaines de ces personnes étant immédiatement expulsées, d’autres étant autorisées à rester aux États-Unis dans l’attente d’une audience visant à déterminer leur demande d’asile). Mais les entrées ont considérablement diminué durant la dernière année de l’administration Biden à raison du durcissement de la ligne du président démocrate. Surtout, alors que l’administration Trump cherche à les présenter comme des criminels, les migrants ne sont, dans leur immense majorité, que des personnes fuyant la situation désespérée à laquelle elles sont confrontées dans leur pays d’origine.
Le président Trump ferme l’entrée de son pays à tous les migrants, y compris aux demandeurs d’asile. Il a en effet promis de rétablir les « protocoles de protection des migrants » (une série de mesures également connue sous le nom Remain in Mexico), mise en place en 2019 puis suspendue pendant le mandat de Joe Biden : les migrants qui sollicitent la protection internationale à la frontière sud sont contraints d’attendre des mois dans des camps sordides au Mexique avant d’obtenir un rendez-vous avec les autorités nord-américaines de l’immigration. Et comme le Mexique semble prêt à coopérer, le programme peut aujourd’hui reprendre.
Par ailleurs, Trump a mis fin à « CBP One », application mobile créée sous l’administration Biden qui permettait aux demandeurs d’asile de prendre rendez-vous pour déposer leur demande d’asile à la frontière sud. Par conséquent, les demandeurs d’asile à la frontière entre les États-Unis et le Mexique ne peuvent plus prendre rendez-vous pour entrer aux États-Unis et y déposer une demande d’asile. Aujourd’hui, tous les demandeurs d’asile sont donc refoulés.
S’opposer au droit d’asile
Toutes ces actions sont probablement légales, comme l’ont établi les tribunaux lors du premier mandat de Donald Trump. En effet, la Cour suprême avait déclaré dès 1892 qu’une nation souveraine a le droit d’« interdire l’entrée d’étrangers dans ses territoires » et que « l’admission aux États-Unis est un privilège accordé par le gouvernement souverain des États-Unis ».
À lire aussi : Le décret anti-réfugiés de Trump, un test démocratique pour les États-Unis
En outre, la loi nord-américaine sur l’immigration donne au pouvoir exécutif un pouvoir discrétionnaire considérable à court terme en matière d’immigration, et en particulier celui d’interdire l’entrée de non-citoyens aux États-Unis pour des raisons de sécurité nationale.
Néanmoins, aucun président n’a le pouvoir de fermer le territoire états-unien à jamais. Le droit fédéral et le droit international autorisent des individus étrangers à demander l’asile aux États-Unis. Trump estime que l’« invasion » de migrants qui est selon lui en cours dans le pays lui donne le droit d’ignorer ces lois. Mais il a tort.
La suspension de l’entrée de tous les demandeurs d’asile semble incompatible avec la convention de Genève de 1951 relative au statut de réfugié : tous les étrangers fuyant les persécutions qui ne bénéficient pas de la protection de leur pays d’origine doivent se voir offrir l’accès aux procédures de demande de protection internationale.
Suspendre le programme d’admission des réfugiés
La seule voie d’entrée aux États-Unis pour les personnes persécutées est donc le programme nord-américain d’admission des réfugiés (les réfugiés sont les personnes qui demandent le statut de réfugié alors qu’elles vivent à l’étranger, tandis que les demandeurs d’asile ne peuvent déposer une demande que s’ils se trouvent sur le territoire des États-Unis).
Sous l’administration Biden, les États-Unis ont admis 60 014 réfugiés en 2023 et 100 034 en 2024 – ce qui est bien en deçà des 142 000 réfugiés admis en 1993, ou des 230 700 accueillis en 1980 (chiffres détaillés ici).
Or, Trump vise à mettre un terme à l’admission de réfugiés, reprenant les politiques de son premier mandat : moins de 50 000 réfugiés étaient alors admis en moyenne chaque année. En 2021, le pays n’avait admis que 11 814 réfugiés. Le président souhaite certainement retrouver un tel niveau et, dans l’absolu, cesser totalement d’accepter des réfugiés.
Le programme nord-américain d’admission des réfugiés donne au président le pouvoir discrétionnaire de fixer le nombre de réfugiés admis chaque année. Cependant, la loi sur l’immigration et la nationalité lui permet de suspendre l’entrée des migrants – même légaux – ce que Trump a fait pour une période d’au moins 90 jours à travers le décret « Réorganiser le programme d’admission des réfugiés aux États-Unis ; protéger le sens et la valeur de la citoyenneté nord-américaine ». Les admissions ne pourront être reprises que si elles sont « dans l’intérêt des États-Unis ». Les réfugiés qui devaient arriver cette semaine ont vu leurs vols annulés.
Placer en détention et expulser des millions de migrants
Trump a déclaré vouloir arrêter et expulser des immigrés sans papiers vivant aux États-Unis « par millions ». Il en a le pouvoir. Toutefois, un droit au « procès équitable » est garanti aux personnes interpellées avant que leur expulsion puisse avoir lieu. Les personnes qui vivent aux États-Unis depuis plus de deux ans ont droit à une audition devant un juge ; il reste à voir ce qui en sera de ceux qui sont arrivés plus récemment.
Reste que l’aide aux migrants, notamment sur le plan juridique, est entravée : les villes et régions qui se sont déclarées « sanctuaires » par exemple, Chicago et San Francisco, ainsi que les ONG qui défendent les droits humains des migrants risquent d’avoir de ne plus avoir accès aux aides fédérales.
Pour parvenir à expulser, l’administration va d’abord devoir interpeller et mettre en détention les personnes concernées. Mais la détention ne peut être indéfinie. Sauf à négocier des accords avec des États tiers qui accepteraient de les recevoir (qu’il s’agisse ou non de leurs États d’origine), l’administration devra généralement libérer les migrants en situation irrégulière après une durée de détention maximale de six mois.
Autre obstacle : les contraintes budgétaires. Le budget actuel de la police de l’immigration est d’environ 9 milliards de dollars. Expulser des millions de personnes supposerait des ressources considérables : plus de 300 milliards de dollars selon certaines estimations, sans même parler de l’impact négatif que leur départ aurait sur l’économie.
Supprimer l’accès à la citoyenneté par le droit du sol
Autre volet de l’action de Trump : mettre fin au droit du sol en matière d’accès à la citoyenneté. Est prévue la suppression de ce droit pour les enfants de migrants en situation irrégulière, mais aussi pour les enfants d’immigrés en situation régulière ayant un permis temporaire. Les agences fédérales doivent refuser à ces enfants passeports, numéros de sécurité sociale et prestations fédérales.
Trump veut en réalité réécrire le « sens » de la citoyenneté états-unienne. Mais il échouera sûrement. Car le droit du sol est inscrit dans le quatorzième amendement de la Constitution, ajouté à la suite de la guerre civile.
Un juge fédéral a déjà bloqué l’entrée en vigueur du décret sur la citoyenneté, le qualifiant de « manifestement inconstitutionnel ». D’autres recours suivront. Pour que ce texte puisse devenir acte de loi, il faudrait que Trump parvienne à convaincre cinq membres de la Cour suprême de « réinterpréter » la Constitution, ce qui paraît à ce stade improbable, même si, aujourd’hui, six des neuf juges de la Cour sont des conservateurs.
… et affronter les réalités
Trump a réussi à instiller la peur des expulsions massives dans les communautés de migrants. Parviendra-t-il à fermer la frontière et à expulser les quelque 12 millions d’immigrés sans papiers ? Non.
Rappelons qu’il avait fait des promesses similaires lors de son premier mandat, et qu’il a quitté le pouvoir sans avoir réduit la population de sans-papiers. Or expulsion et détention ont un coût financier et, aussi, politique. De nombreux Nord-Américains seraient sans doute outrés de voir des enfants séparés de leurs parents ou des voisins expulsés d’églises et d’écoles, et devraient également s’opposer aux conséquences économiques d’une disparition de la main-d’œuvre sans papiers.![]()
Marie-Laure Basilien-Gainche a reçu des financements de l'IUF.
Amanda Frost ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.








![[RÉACTION] « A Nice, la statue de Jeanne d’Arc restera ! »](https://media.bvoltaire.fr/file/Bvoltaire/2025/02/entretien-ecrit-vardon-720-616x347.jpg?#)