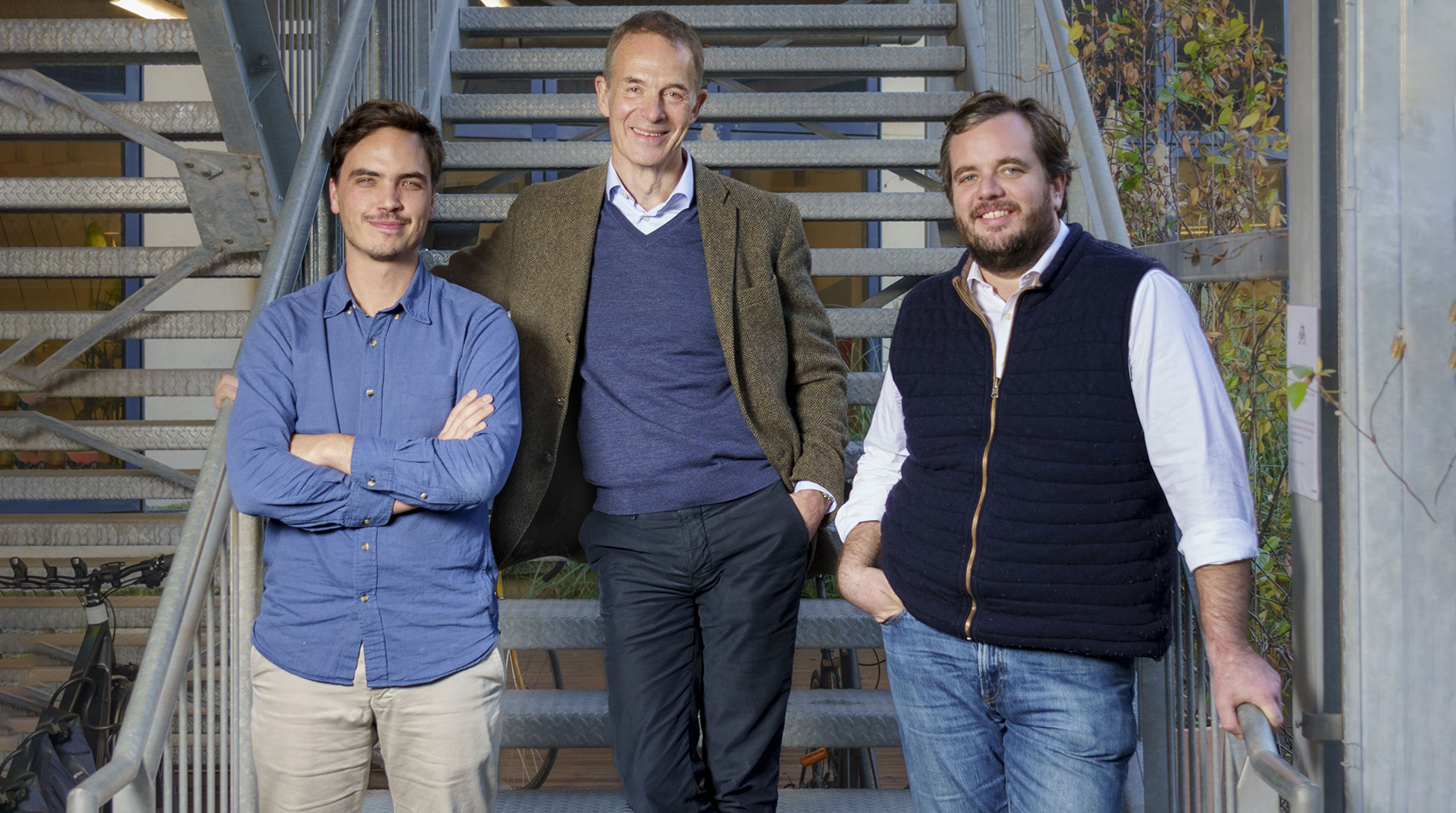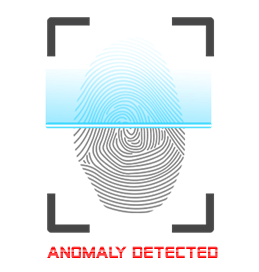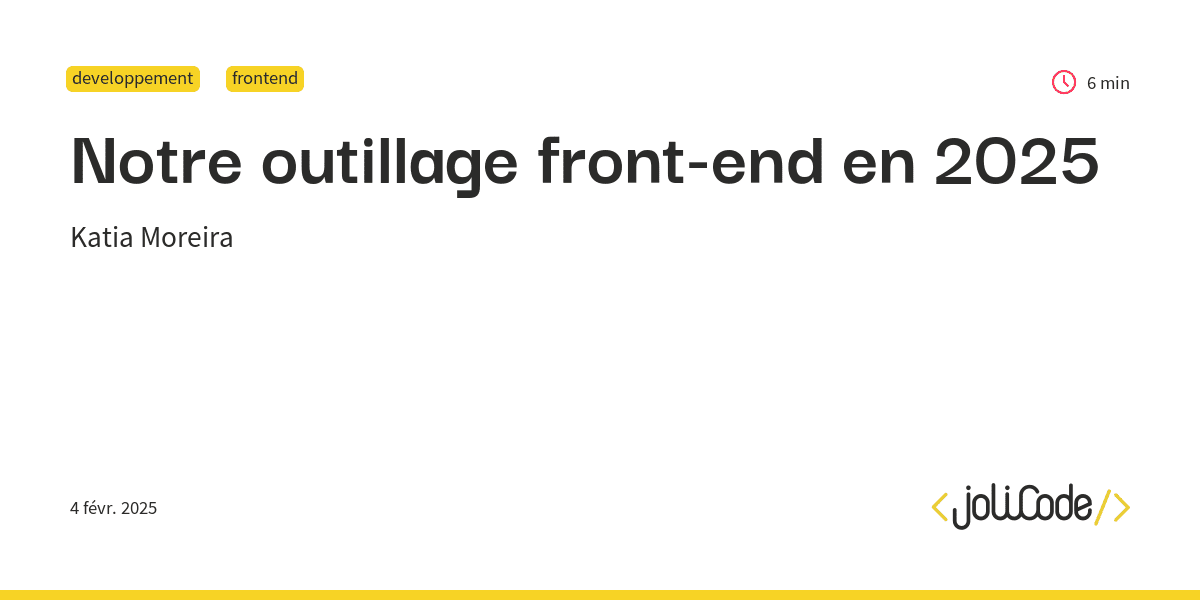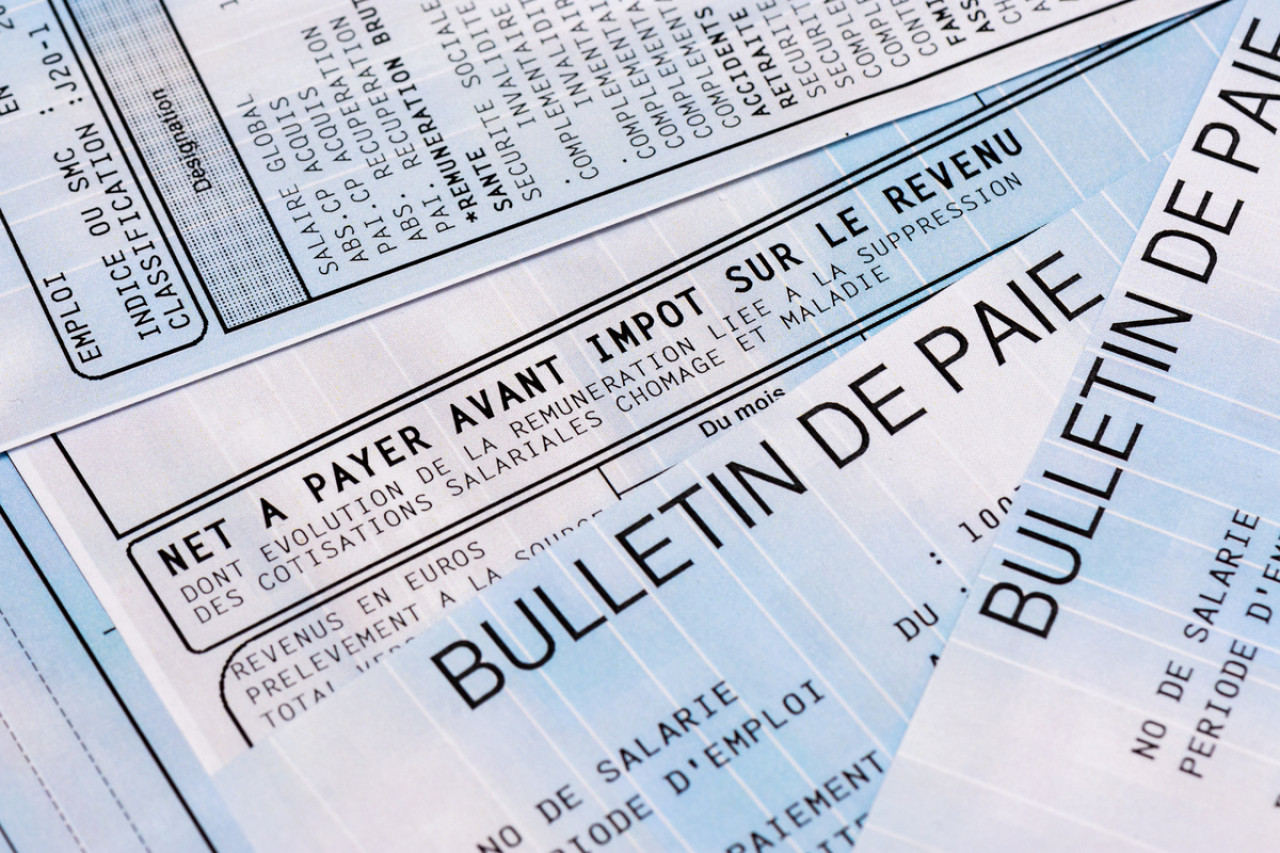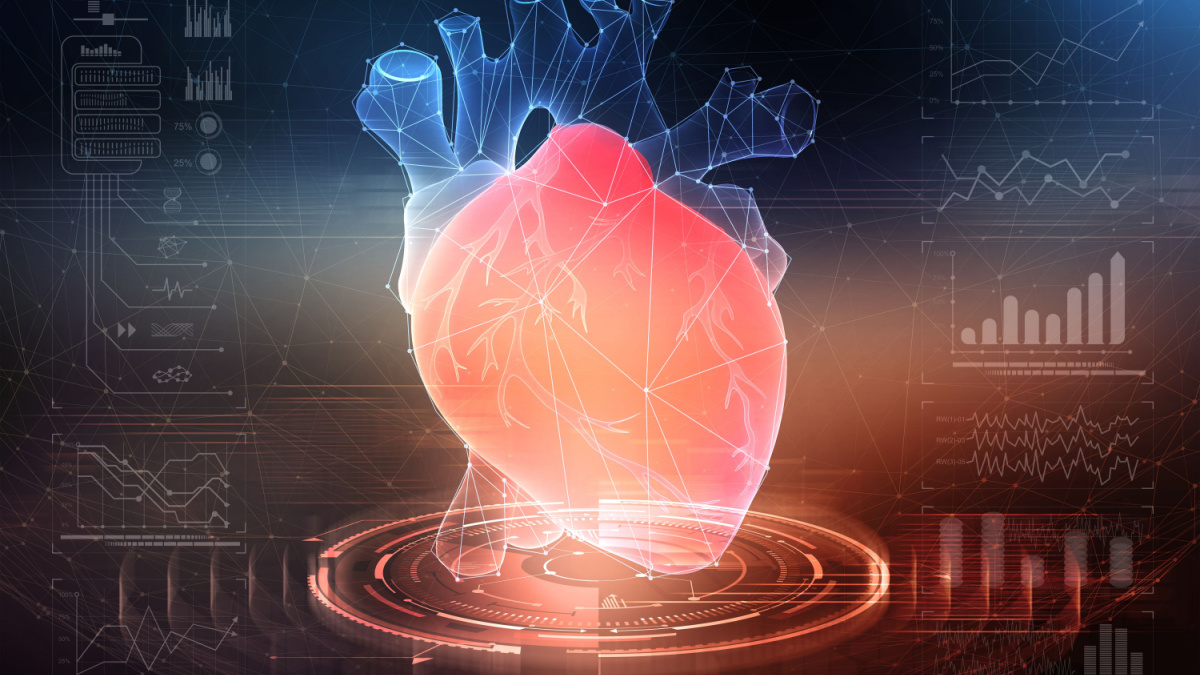Ne pas lire les livres imposés au collège ou au lycée, c’est grave ?
Les élèves qui ne lisent pas les œuvres imposées à l’école sont-ils pour autant insensibles à la littérature ? Que nous apprennent les non-lecteurs scolaires des enjeux de la lecture ?

Les élèves qui ne lisent pas les œuvres imposées au collège ou au lycée sont-ils pour autant insensibles à la littérature ? Se pencher sur ce public, assez important, de non-lecteurs scolaires permet d’interroger les enjeux que revêt aujourd’hui cette pratique culturelle, et la manière dont l’institution scolaire les met en musique.
De son institution en grande cause nationale à la mise en place du « quart d’heure de lecture » dans les classes, la lecture ne cesse d’être au cœur de débats et de préoccupations. À l’époque des écrans et des réseaux sociaux, la baisse de la place du livre dans les pratiques culturelles des adolescents inquiète tout particulièrement.
Cette injonction à la lecture n’a pourtant pas toujours existé. Il est bon de rappeler que, jusqu’aux années 1960, lire trop ou lire de mauvais genres était non seulement perçu comme futile mais comme dangereux. En classe, la non-lecture des œuvres a longtemps été la norme. On y étudiait des fragments et non des œuvres intégrales. Dans les années 1920, l’apparition des petits classiques constitués d’extraits de romans, d’anthologies de poésie ou de pièces de théâtre marque une première étape en rendant les œuvres accessibles. Mais il convient encore de lire avec modération et exclusivement des œuvres triées.
En effet, il faut attendre les années 1960-1970 pour que les instructions officielles exhortent les enseignants à transmettre à leurs élèves non seulement la pratique de la lecture mais aussi le goût de lire. Actuellement, on s’inquiète de la non-lecture des jeunes mais, dans l’histoire de la lecture, l’inversion des valeurs est relativement récente.
La non-lecture des œuvres au programme : une pratique courante
L’école est désormais prescriptrice : elle donne à lire et fait lire. Pour autant, sauf à faire preuve d’une grande naïveté, on se doute bien qu’il ne suffit pas de donner à lire pour que lecture soit faite, surtout si le temps et l’espace de cette lecture se situent hors du champ de contrôle de l’enseignant, c’est-à-dire à la maison, après la classe.
Les élèves qui dérogent à l’obligation scolaire de lire les œuvres imposées par leur enseignant de français n’ont jusque-là jamais fait l’objet d’une étude minutieuse. Certes, on a pu croiser certains d’eux dans les études des chercheuses Bénédicte Shawky-Milcent, Cendrine Waszack et surtout Stéphanie Lemarchand. Mais l’on n’y apprenait pas exactement qui sont ces élèves et comment ils travaillent avec (plutôt que malgré) leur non-lecture.
Pour mieux connaître ceux que j’appellerai donc les non-lecteurs scolaires (pour distinguer les pratiques privées des pratiques scolaires, car l’on peut lire beaucoup pour soi et très peu pour l’école), j’ai suivi durant une année une classe de seconde d’un lycée socialement mixte, filmant les cours, interrogeant les élèves (questionnaires et entretiens) et recueillant leurs travaux (copies, exposés).
Mon étude montre que la non-lecture des œuvres imposées dans la classe étudiée est une pratique assez fréquente. Sur 35 élèves, seuls 6 élèves sont des lecteurs réguliers des œuvres imposées. Mais parmi les 29 autres élèves, les profils diffèrent : 5 sont des non-lecteurs scolaires réguliers, alors que 21 autres élèves oscillent entre lecture et non-lecture selon les œuvres et les moments de l’année.
Contrôles de lecture et résumés sur Internet
Fini le temps des Profils d’une œuvre que les élèves allaient acheter en librairie ou empruntaient en bibliothèque, Internet a mis à disposition d’autres ressources. Pour pallier leur non-lecture, les élèves recourent, de manière assez majoritaire, à des résumés qu’ils vont chercher sur Internet.
La recherche de résumés n’est cependant pas réservée aux élèves qui n’ont parcouru qu’une part très réduite de l’œuvre à lire. Les lecteurs n’hésitent pas eux aussi à s’aider d’un discours second sur l’œuvre, pour s’assurer de l’avoir bien comprise ou pour se rafraichir la mémoire avant le contrôle de lecture.
À lire aussi : Littérature classique : que penser des versions abrégées, d’Homère à Jules Verne ?
Le contrôle de lecture est un exercice scolaire auquel les lycéens rencontrés sont habitués. Ils en anticipent les questions qui portent bien souvent sur l’histoire, interrogée de manière très générale (Qui ? Quand ? Où ? Quoi ?), mais aussi dans ses moindres détails. La visée de ces questions plus pointues est précisément, dans l’esprit des enseignants, de départager les lecteurs et les élèves qui se seraient contentés de lire un résumé.
S’il est vrai que, globalement, les lecteurs réussissent mieux ces évaluations, d’habiles non-lecteurs sont cependant eux aussi tout à fait en mesure d’obtenir de très bons résultats. Il arrive aussi que certains lecteurs ne soient guère récompensés des efforts engagés.
[Déjà plus de 120 000 abonnements aux newsletters The Conversation. Et vous ? Abonnez-vous aujourd’hui pour mieux comprendre les grands enjeux du monde.]
Ces injustices scolaires sont d’ailleurs pointées par certains élèves comme l’une des sources de l’abandon de la lecture des œuvres imposées ; certains les réussissent même mieux depuis qu’ils ne s’encombrent pas d’une lecture souvent difficile. Mais les contrôles de lecture ne sont pas les seuls exercices où l’on voit certains non-lecteurs en meilleure posture que certains lecteurs. D’autres études que la mienne ont déjà mis en évidence l’absence de corrélation entre lecture et réussite scolaire.
Des critères scolaires éloignés d’un rapport authentique au livre ?
Comment se fait-il qu’on puisse réussir à l’école en lisant peu les œuvres imposées et échouer, parfois, en les lisant beaucoup ? Tout d’abord, parce que lire une œuvre a en effet peu à voir avec la consignation méticuleuse de données narratives, et l’école a tendance à l’oublier. Le lecteur circule toujours de manière singulière dans une œuvre, il y projette son histoire et ses fantasmes, occulte certains détails pour progresser dans sa lecture, retient tel passage plutôt que tel autre.
Or, l’école s’appuie sur une tout autre représentation de la lecture qui nécessite au contraire de maitriser avec précision les données d’une histoire, maitrise perçue comme la preuve d’une lecture effective et de la compréhension de l’œuvre.
Ensuite, parce que, dans les programmes du lycée, les savoirs savants afférant à une œuvre (caractéristiques du genre, du mouvement littéraire, maitrise des outils d’analyse) occupent une place prépondérante. On peut alors les maitriser sans lire les œuvres pourvu qu’en classe on ait suivi attentivement leur étude.
Enfin, il est loin d’être sûr que les épreuves du baccalauréat (explication de texte pour l’oral, commentaire ou dissertation pour l’écrit) autorisent une parole authentique sur les œuvres. Les élèves gagneraient plutôt à produire un discours acceptable et recevable par tous, plus proche de la doxa et d’un éloge informé. L’expérience de lecture est-elle dans ces conditions vraiment nécessaire ?
Se constituer une « bibliothèque intérieure »
Si l’école a donc une part de responsabilité dans la désaffection des œuvres par les élèves, le tableau est loin d’être tout noir. L’analyse de certaines séances de classe montre l’investissement de certains non-lecteurs dans l’étude des œuvres. Leurs entretiens le confirment et certaines de leurs productions (orales ou écrites) témoignent même d’un investissement subjectif dans leurs discours sur les œuvres non lues.
À lire aussi : Littérature : s’approprier les classiques, un défi pour les lycéens
Malgré leur non-lecture, des élèves peuvent tisser un lien avec l’œuvre non lue qui se fait ainsi une place dans leur bibliothèque intérieure et les aide à circuler dans notre culture. Comme le soulignaient aussi bien Pierre Bayard dans Comment parler des livres que l’on n’a pas lus que Julien Gracq dans les Carnets du grand chemin, les livres non lus peuvent avoir un retentissement aussi fort que certaines œuvres lues :
« Les livres que nous avons lus sont bien loin d’être les seuls éléments de notre culture livresque. Comptent aussi, parfois presque autant, ceux dont nous avons entendu parler, d’une manière qui nous a fait dresser l’oreille. » (Julien Gracq)
Quelle est cette manière qui fait « dresser l’oreille » ?
Probablement les dispositifs qui favorisent l’émergence d’une parole subjective, ceux qui permettent aux élèves de confronter leur compréhension et leur interprétation de l’œuvre ou d’un extrait, de susciter des questionnements sur le monde que l’œuvre a soulevés et de débattre (cercles de lecture, débats interprétatifs). Autant de temps précieux où l’œuvre entre en contact avec les préoccupations de ces adolescents et avec le monde qui les entoure.![]()
Maïté Eugène ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d'une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n'a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.